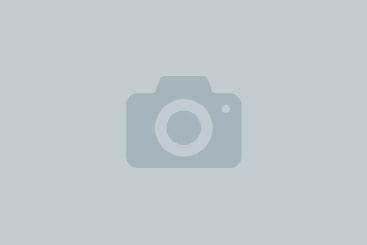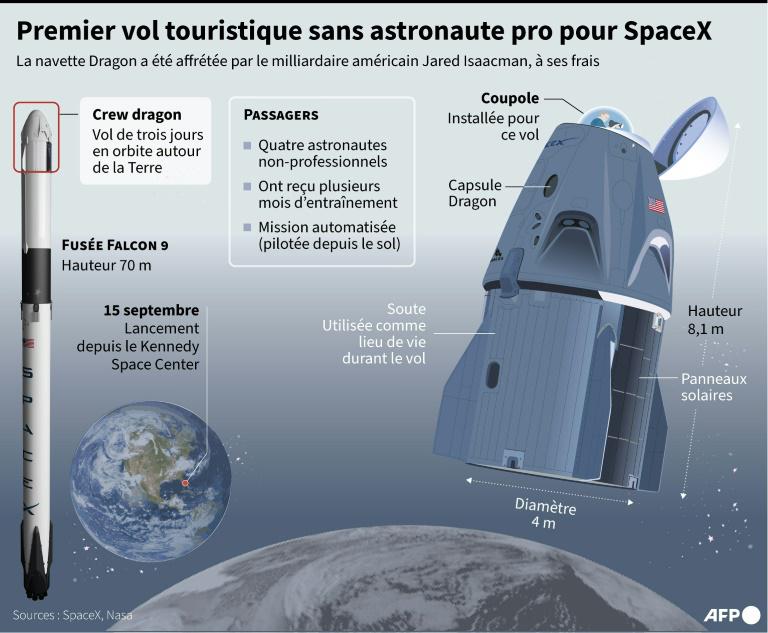Mick Jagger : "L'album est en cours MAIS !" - Rolling Stone
Johnny Cash, l’homme en noir est la plus grande légende de la country. Un volume entier lui est consacré dans le coffret de la série-documentaire Country Music de Ken Burns. Retour sur une trajectoire hors du commun
31 janvier 2003 : Johnny Cash dévoile le clip du titre « Hurt ».
American Recordings permit à l’homme qui s’habillait de noir d’ôter sa défroque de has-been country et de se réaliser in extremis en héros définitif. Dans la plus belle tradition du come-back à l’américaine, il était venu, il avait vaincu, avait chuté puis ressurgi d’entre les disparus. En sauvant sa peau d’artiste, Johnny Cash, même mort, resta vivant. Aujourd’hui, ses chansons, surtout les premières, celles gravées chez Sun Records, et les dernières, arrachées par Rick Rubin, appartiennent au Great American Folkbook, comme celles de Cole Porter, George Gershwin, Duke Ellington, Woody Guthrie, Muddy Waters, Chuck Berry ou Bob Dylan.
Les premières notes de la chanson se dispersent dans le studio. Alain Bashung s’empare du casque posé sur la table et le met sur ses oreilles. Avant de fermer les yeux, il écrase sa cigarette à l’intérieur d’un bobino en laiton, l’un de ceux que l’on utilisait autrefois à la radio pour caler des bandes magnétiques et qu’on trouve encore, fantômes délaissés, prenant la poussière dans les studios. Il écoute “Thirteen”, ses mains encadrant les écouteurs, la tête haute. Lorsque la chanson se termine, il lève son pouce. Interrogé par l’animatrice, il allume d’abord une autre cigarette. À l’antenne, on entend le “ploc” du briquet qui s’ouvre et se referme, puis Bashung lance, lapidaire : “Cash. Johnny Cash. Rien que son nom, t’as compris. C’est un peu John Wayne, sauf qu’il ne jouait pas la comédie. Il est cash. Voilà, pas de cache-cache avec Cash.”
Soyons honnête, les premières fois que l’on aperçoit Johnny Cash, c’est à la télévision, en guest star, dans un épisode de Colombo, au “Muppet Show” ou dans la série sur la guerre de Sécession, Nord et Sud. C’est au tournant 1970-1980, années noires pour lui, même si Jimmy Carter, un parent, est à la Maison-Blanche. Son show diffusé sur ABC, où il a pourtant reçu Louis Armstrong, Dylan, Merle Haggard, Joni Mitchell, Bill Monroe, Neil Young, Roy Orbison, Marty Robbins, Ray Charles, J. J. Cale ou Stevie Wonder, s’est arrêté.
Il est devenu un notable de la musique, croulant sous les hommages, citoyen d’honneur du Tennessee, parrain de la country. Il donne beaucoup d’argent aux œuvres de charité ; en 1987, en tournée en Pologne, il écrit une lettre à Lech Walesa pour soutenir Solidarnosc ! Bref, ça sent le sapin, la retraite. Prestigieux mais démodé, il est logiquement jeté par sa maison de disques en raison de la faiblesse des ventes d’albums pas terribles.
Étendard de la country
Lucide, il s’autoparodie avec “Chicken in Black”, dont l’ironie reste en travers du gosier des pontes de Columbia. “Allez, ouste, dehors !” Le chanteur country Dwight Yoakam, dont on adore le Guitars, Cadillacs, Etc., Etc., monte au créneau : “C’est Johnny qui a payé le bureau dans lequel le trou du cul qui l’a viré passe ses journées !”
Vexé mais indifférent, Cash hausse les épaules et reprend la route avec ses copains du Mont Rushmore de l’outlaw country, Waylon Jennings, Kris Kristofferson et Willie Nelson, The Highwaymen.
À cet instant précis, les radios ont cessé de le diffuser, ses tournées ne passent plus par la France depuis un concert donné au théâtre des Champs-Élysées en 1976. On écoute plus volontiers la nouvelle vague, Yoakam donc, le jeune et beau Steve Earle, James McMurtry, voire Jason & The Scorchers, Lone Justice, Violent Femmes ou Cowboy Junkies. Le mélange des sons, des âges, des villes (Austin, Athens, Tucson) revitalise une country dont il a été l’étendard à sa voix défendante, lui, mouton noir à peine toléré puis éjecté du “Grand Ole Opry” un soir où, croyant entendre Jésus, il flingue une rangée de projecteurs, quitte la scène et se perd dans la nuit.
Ainsi, physique alourdi, répertoire en berne, production sirupeuse, pochettes de disques improbables, position floue, Johnny Cash, à la fin des années 1980, est proche de la sortie de route.
Dust to dust

Ne jamais oublier d’où viennent nos préférés. C’est par un voyage en camion que ça commence. Celui qui emmène la famille Cash des collines du sud de l’Arkansas au delta du Mississippi, deux cent miles plus au nord, en 1935. Roosevelt à la manœuvre à Washington, Carrie Cash, comme sur une photo de Dorothea Lange, calme les pleurs des enfants en chantant. Et J. R. – il ne devint John qu’en s’engageant dans l’armée – harmonise avec elle. “Mon fils, tu as le don”, souffle-t-elle. L’orage gronde, J. R., haut comme trois pommes, sourit, mais il est terrorisé. Par les trombes d’eau ? Par la révélation maternelle ? Par la promesse ?
La cahute des Cash, à l’arrivée à Dyess, offre boue et eau non potable. Quelques acres et une mule, des clous et de fragiles planches en guise d’abri, le même que celui du môme de Tupelo qui naît un peu plus à l’est de l’État ; c’est celle des “fermiers de la galère” de Steinbeck, celle, musique oblige, du Honkytonk Man d’Eastwood. De la poussière. Demande à la poussière, retourne à la poussière, dust to dust.
Alors, la voix de Cash sera prise par la poussière comme jamais ne le sera celle de soie du môme de Tupelo, pourtant aussi pauvre que lui, mais assez vite urbain, assez vite à Memphis. Johnny, enfant de la rivière et des bois, aime rêver, pêcher, écouter Jimmie Rodgers, Hank Williams, The Carter Family, Ernest Tubb, Hank Snow, Huckleberry Finn, à la radio. Et apprendre la guitare avec un voisin atteint de polio, Django des marais, main droite atrophiée, main gauche diablement habile.
Ils jouent, pendant que la Cash Family ramasse le coton. J. R. n’est pas là, d’ailleurs, lorsque son frère aîné, Jack, est déchiré de l’entrejambe jusqu’au torse par une scie à bois électrique. À l’agonie, le frangin décrit la porte du paradis, puis ferme les yeux. J. R. perd son préféré, son Jesse Garon. Dès lors, rien n’est plus pareil, s’en fout la mort, s’en fout la vie. Partir, dériver ; hobo dès qu’assez mûr pour essayer d’oublier, y penser pourtant tous les jours, toutes les nuits. I forgot to remember to forget.
D’ailleurs, saut dans le temps, on a beau chercher, scruter les photographies, les bouts de film, les reportages, celui qui ne rit jamais, le Buster de la bande, c’est bien lui. Nous sommes en 1955, il est souvent le plus vieux de l’équipée sauvage, le seul en tout cas à avoir déjà femme et enfant. Cash garde ses sentiments pour lui, pour plus tard. Il ne dit jamais grand-chose, il écoute, orgueilleux mais modeste, ouvre ses magnifiques oreilles qui, lors de ses trois ans dans l’US Air Force, lui ont permis d’être le premier Américain à apprendre que Staline était mort.
© Droits réservés
Le creux de la vague
L’une des seules fois où il se départ de sa timidité, c’est pour lancer à June Carter qu’un jour ils se marieront. Bref, ils sont là, en noir et blanc, jeunes, beaux, arrogants, mettant le feu aux gorges des teenagers, faisant s’étrangler les honnêtes gens, semant la révolte dans l’Amérique bien-pensante. Elvis, Scotty Moore, Bill Black, Carl Perkins, Buddy Holly, Wanda Jackson, Johnny Cash et ses musiciens, Marshall Grant et Luther Perkins, qui inventent le son de Cash, un roulis de train étouffé et implacable. Johnny est l’un de ceux auxquels Sam Phillips a donné sa chance dans l’écume laissée par le King. Pour Sun Records, il grave “Get Rhythm”, “Big River”, “Train of Love” ou “I Walk the Line”, l’une de ses chansons fétiches.
Mâchoire fermée, silhouette de corbeau, guitare Martin portée sur le flanc, Johnny Cash aligne les galas, les kilomètres et les standards, saccageant toutes les chambres de motel qu’il trouve sur son chemin, seulement guidé dans sa nuit par la couleur des pilules qui éloignent fatigue et douleur. Feu rouge, feu orange, feu vert. Encombré par son chagrin, sa pauvreté, sa timidité et sa voix, il fonce, tombe, se relève, donne un concert, puis un autre, un autre et un autre. Enfin, il meurt. Croit mourir. Est sauvé par June Carter. Et là, bingo bigot ! Celle à qui Elvis écrivait de tendres lettres lui accorde enfin sa main. La famille Carter entre dans sa vie, il s’en accommodera, accordant quelques gages, inventant quelques miracles, donnant des sous ou tournant un film sur la vie de Jésus avec Billy Graham, leur Khan, leur gourou. Car, dans le Sud (cf. Jerry Lee Lewis et Jimmy Swaggart), Saintes Écritures et musique du diable sont jumelles.
L’auto-hagiographie de Cash (belle traduction en français d’Emmanuel Dazin) raconte en détail ce stupéfiant combat infernal. D’intox (“J’ai vu la lumière”) à cures de désintox, apparemment rangé des voitures, the devil inside, il fonde une autre famille, apprend à sourire et fait le boulot. Tous les jours sur la route avec le “Johnny Cash Show”, il multiplie les albums concepts : les cow-boys, les Indiens, les trains, les prisons, la guerre civile. Il rencontre Bob Dylan, un fan, et leur amitié scelle le chaînon qui manquait entre Elvis et Bob. Trinité en place dans les cieux, le rock américain s’efface pourtant, les Anglais déboulent de nouveau, inondant le Delta avec leur pop, leurs franges et leurs décibels. Johnny, quarantaine, puis cinquantaine approchant, déprime. Trop de bons sentiments, pas assez de bons disques. La corde se noue autour de son cou, engluée d’amour et de ressentiment.
Capture d’écran YouTube
Clown noir
Une année, à paris, 1994, en quelques jours séparés par une brusque chaleur, on écoute Nick Cave le 14 juin à l’Olympia et Johnny Cash le 29 à l’Élysée-Montmartre. À l’époque, ils ne se sont pas encore rencontrés, mais les fluides transpirent. Men in Black évidemment, tous les deux, sans que l’on sache lequel est le plus moderne, le plus sanglant, le moins jouasse. À l’Élysée, Cash, entouré de sa famille, propose un récital presque convenu, sobre, classique. Puis, revenant seul, il joue quelques extraits de son nouveau disque : “Delia’s Gone”, “The Beast in Me” ou le fameux “Thirteen” de Glenn Danzig. Il sourit, clown noir soudain, heureux comme un bohémien, libre sans les violons et la pedal steel. L’ovation qui suit chaque extrait des American Recordings de Rick Rubin, frais de quelques semaines, pas encore encensés par la critique ou l’establishment de Nashville – aussi prompt au retournement de veste qu’à l’embaumement –, est à la mesure de l’attente. So long, Johnny, good to see you…
En cette fin de siècle, Cash devient le Rembrandt de la country, peignant de crus autoportraits plus noirs que la cendre, au clair-obscur de sa vie, aidé d’un docteur Gachet du rap, le producteur de LL Cool J, de Slayer ou des Red Hot Chili Peppers. Rick Rubin est son Alan Lomax, l’ultime accoucheur de ses peurs, chasseur de spectres, révélateur d’ombres. Pendant près de dix ans, ils chevauchent ensemble, revisitant le répertoire, esquissant des mémoires américaines. Et l’homme, se penchant sur son passé, retrouve sa dignité musicale.
Mal perçue à ses débuts par l’entourage de Cash, la rencontre entre un Gargantua trash – cheveux longs, pieds nus, barbe fleurie – et, dixit Rubin, “un grand artiste, mais qui ne faisait plus de grands disques” est une improbable alchimie, une recette que d’autres essaient de reproduire avec plus ou moins de bonheur, le vieux et le jeune, Wanda Jackson ou Loretta Lynn et Jack White, Dr. John et Dan Auerbach, etc. Avec Rick Rubin, Cash retrouve la vérité du studio Sun, à Memphis, lorsque Sam Phillips lui disait : “Bien, Johnny, bien. Encore une. Tu en as bien encore une ?” jusqu’à ce que “Hey Porter” passe la gorge du communiant.
© by RB/Redferns/Getty Images
Alors, la boucle se refermant, delta sur le Delta, le boulot terminé, des centaines de chansons collectées par Rubin, plus qu’à disparaître. La nuit sera longue à venir. Pneumonie, coma, paralysie, mort de June Carter, le chêne s’écorche, mais écorce après écorce. Et, lorsqu’il faudra enfin s’évanouir, comme Red Stovall, le musicien honkytonk d’Eastwood, Johnny mourra la guitare à la main, en jetant ses dernières forces dans la bataille. Bésicles sur le nez, la pénombre l’entourant, guitare et voix au ceinturon. Cette voix du bout de la route, cette voix, chariot prêt à verser dans le précipice.
Une dernière chanson avant de fondre au noir. Ce sera “Hurt” de Nine Inch Nails : “I hurt myself today / To see if I still feel.” Le clip, tourné par Mark Romanek, confronte le Johnny crépusculaire à un Cash solaire, jeune, affamé, beauté dangereuse. On y voit June, des trains, des taulards et la maison de l’enfance. Puis, dans la résonance de l’accord du piano, Johnny referme le couvercle comme celui du cercueil, non sans avoir murmuré un dernier couplet : “If I could start again / A million miles away / I would keep myself / I would find a way.”
Pour en apprendre davantage sur cette série documentaire événement, c’est dans le dernier numéro de Rolling Stone que ça se passe ! Et il est disponible juste ICI !
Arte dévoile un coffret regroupant tous les épisodes de cette série événement. Il est disponible en support physique et en digital par ici.
Episode 1: Les débutsEpisode 2: Hard Times (1933-1945)Episode 3: Le Shakespeare hillbilly (1946-1952)Episode 4: I Can’t Stop Loving You (1953-1963)Episode 5:Les enfants de l’Amérique (1964-1968)Episode 6: Will the Circle Be Unbroken?(1968-1972)Episode 7:Are You Sure Hank Done It This Way? (1973-1983)Episode 8: La musique vaincra (1973-1983)Episode 9: Don’t Get Above Your Raisin’ (1984-1996)
Bande-annonce :
Belkacem Bahlouli