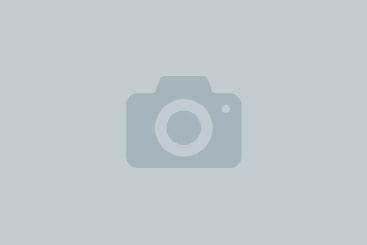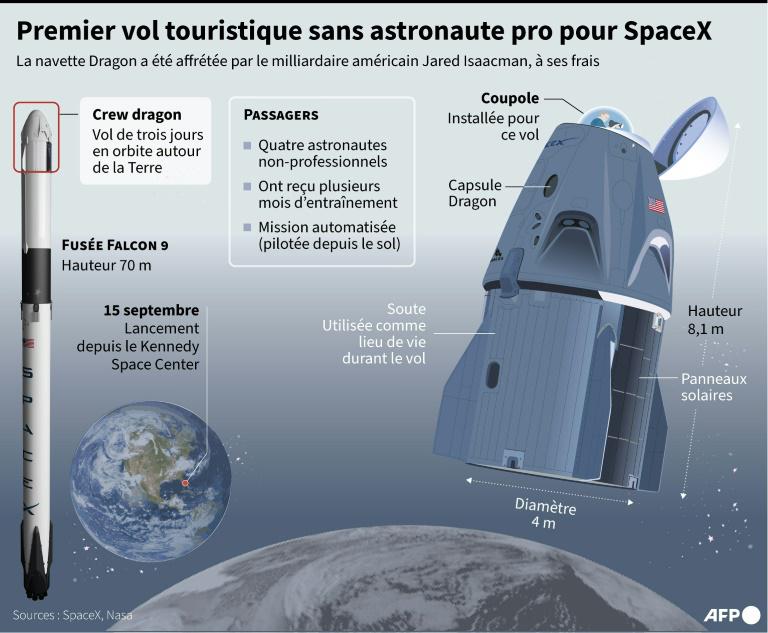DIACRITIK Le 17 octobre 1961 : William Gardner Smith, la fiction et l’événement Recevez les alertes Mail Mentions légales Navigation des articles
Certains événements résistent à être « racontés ». Le 17 octobre 1961 en fait partie. Pourtant, comme souvent, la fiction était déjà au rendez-vous. Le roman de William Gardner Smith,Le Visage de pierre, vient d’être enfin traduit en français : on découvre alors comment un jeune Afro-Américain venu à Paris pour s’éloigner de son pays a introduit dans son récit, dès 1964, ce qu’il a vu et vécu. Les écrivains français ne s’y mettront que plus tardivement : Didier Daeninckx en 1984 ; mais aussi Leïla Sebbar en 1999 et Thomas Cantaloube en 2019.
Revenir aux faits
On sait tout ce que l’on doit, sur cet événement au cœur de Paris, aux recherches obstinées de Jean-Luc Einaudi (1951-2014). Le premier état de ses recherches paraît, en 1991 aux éditions du Seuil sous le titre La Bataille de Paris – 17 octobre 1961. Ce livre a été réédité en poche avec une postface inédite de l’auteur en 2001. Au procès Papon, en 1997, Einaudi avait témoigné devant la cour d’assises de Bordeaux sur le massacre des Algériens le 17 octobre 1961 ; Papon, s’il a été condamné pour ses actions pour la déportation des juifs, ne l’a jamais été pour la répression sauvage contre les Algériens. Jean-Luc Einaudi, pour poursuivre sa recherche de vérité, avait déposé le 8 février 1998 aux Archives de Paris une demande d’accès qui a été refusée. Le 20 mai 1998, il publiait dans Le Monde un article où il dénonçait un « massacre ». Papon qui avait été soutenu au plus haut niveau de l’État, a porté plainte pour diffamation.
En 2015, Fabrice Riceputi a publié aux éditions Le Passager Clandestin, un ouvrage revenant sur l’enquête d’Einaudi : La Bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République ; plus récemment, en septembre 2021, a été publié Ici on noya les Algériens avec une préface d’Edwy Plenel et Gilles Manceron. Pour qui veut s’informer, les documents ne manquent pas, d’autant que ces livres ont provoqué des polémiques et sont donc sortis du silence auquel on cantonne bien des ouvrages gênants. Mais le fait lui-même du massacre n’est plus remis en question.
On se reportera aussi au magnifique reportage photo de Jean-Philippe Cazier, le 17 octobre 2021 dans Diacritik, pour la commémoration de cet événement, avec cette présentation : « Le 17 octobre 1961, pour protester contre le couvre-feu imposé aux seuls immigrés maghrébins, en particulier Algériens, une manifestation est organisée à Paris. L’État français réprime cette manifestation par la violence et dans le sang : arrestations, coups, meurtres perpétrés par la police française. Le slogan le plus scandé lors de la commémoration de cet après-midi qui a eu lieu à Paris est : « ouvrez les archives ! » ».
Le visage de pierre de William Gardner Smith
Il est toujours fascinant de découvrir une œuvre qui garde toute son actualité. C’est le cas de ce roman édité aux États-Unis en 1963, il y a 58 ans… Grâce à la traduction aux éditions Bourgois, il est désormais accessible en français. Comment expliquer cette omerta puisque, malgré la demande de l’écrivain qui résidait en France, il n’a pas été traduit ? Il semble bien que la raison est l’événement intimement tissé dans la fiction : ce massacre des Algériens à Paris. La phrase qui accompagnait le lancement du roman aux États-Unis met en avant la drôle de sensation d’un Noir Américain à Paris d’être considéré « comme un Blanc ».
L’ouvrage de Michel Fabre, La Rive noire. Les écrivains noirs américains à Paris. 1830-1995, indique clairement la place qu’occupe William Gardner Smith : « La France a représenté pour les Noirs américains une terre de liberté. Arrivés sur les champs de bataille de la Grande Guerre avec le jazz dans leurs bagages, ils ont par la suite représenté une présence culturelle constante. Aux heures difficiles du maccarthysme, les expatriés se réunissaient dans les cafés du Quartier latin autour de Richard Wright, Chester Himes et William Gardner Smith tandis que James Baldwin cherchait son identité à Belleville. Très écorné par la colonisation, puis par la guerre d’Algérie et la montée du racisme, le mythe de la France libérale et accueillante pour les écrivains et les artistes noirs américains subsiste encore aux années du Pouvoir noir. Il est perceptible à travers les impressions et les œuvres de contemporains. »
William Gardner Smith s’installe à Paris dès 1951. Il y restera et résidera en Île-de-France ; il meurt à Thiais en 1974, à l’âge de 47 ans après de brillantes années de correspondant à l’AFP dès 1954, envoyé dans différents pays. Sur la couverture de la traduction française, c’est un portrait de l’auteur qui apparaît, confirmant ce que l’on pressent à la lecture : Simeon Brown est son double et que, comme lui, il est hanté par un visage de pierre qu’il peint sans cesse sans parvenir à l’achever.
Le roman mêle avec beaucoup de doigté et de réalisme la vie libérée d’hommes et de femmes ayant échappé au racisme quotidien, ouvert ou insidieux qu’ils ont subi au pays et la découverte que, sous les apparences, d’autres « négros » sont pourchassés dans ce pays de liberté, les Algériens en lutte pour leur indépendance. En trois parties aux titres révélateurs, Simeon passe de la légèreté du quotidien parisien à la lourdeur injuste du monde avec une question qui nous apparaît comme centrale : « peut-on échapper au racisme ? » ; les titres de ces parties soulignent une progression : « Le fugitif », « L’homme blanc », « Le frère ». Une de deux citations mises en exergue annonce en quelque sorte l’impression dominante du récit : « J’ai été un étranger en terre étrangère » (Exode II, 22).
Un Américain, un Noir, du nom de Simeon Brown, d’une trentaine d’années, arrive en train à la gare Saint-Lazare, après avoir débarqué d’Amérique au Havre : « Quel long voyage ! pensa-t-il. L’Amérique était derrière lui, son passé aussi ; il était en sécurité. La violence ne serait pas nécessaire, le meurtre non plus. Paris. La paix ». En ce mois de mai 1960, il observe avec curiosité la foule qui l’entoure, ces rues pleines de monde. Mais déjà apparaît, dans le paysage, une discordance : « Et ces hommes qui marchaient en groupe vers lui, aux cheveux crêpelés et à la peau tout à fait blanche, mais sûrement pas noire ? Ils avaient un regard triste, abattu, furieux, un regard que Simeon connaissait pour l’avoir vu dans les rues de Harlem. Un pantalon informe, des chaussures usées, une chemise miteuse. Ils observaient Simeon sans sourire, et une chose qui ressemblait étrangement à de la reconnaissance circulait entre eux et lui. Puis ils le dépassaient et disparaissaient » (p. 15).
Première « rencontre », premier malaise. Puis à la terrasse d’un café où il tente d’aborder une jeune femme qui le rejette, il pense : « Le racisme. Il était omniprésent. Il était ici aussi, à Paris ». Même si, dans ce cas il y a méprise, le lecteur adopte la suspicion constante, et malheureusement souvent fondée, qui est celle de Simeon. Après une première installation dans un hôtel et la reprise de la peinture qu’il transporte avec lui, celle d’un visage terrible, Simeon sort et capte un titre de journal : « Émeute de musulmans à Alger. Cinquante morts » (p. 18). Le soleil brille et Simeon veut savourer la liberté ; mais aussitôt, un homme croise sa promenade : « Un homme d’âge mûr, à la peau basanée et aux longs cheveux crépus, poussait une charrette de fruits et légumes. Il aurait pu faire partie du groupe d’individus aperçus par Simeon devant la gare Saint-Lazare à son arrivée. Ces gens étaient-ils des Algériens ? Transpirant sous le poids de la charrette, il adressa à Simeon un regard qui n’était ni amical ni hostile, seulement curieux. Pour des raisons qu’il ne comprit pas tout à fait, Simeon se sentir submergé par une bouffée de culpabilité » (p. 19).
Décidément, ces hommes différents ne le laissent pas savourer son évasion hors de l’Amérique ! Un compatriote qu’il rencontre, le prend en charge et l’introduit dans le milieu des Américains Noirs à Paris et lui rappelle, sans le savoir, sa raison d’être là : « J’aime bien voir les petits gars s’affranchir des emmerdes. Une victime de moins. Ah, si l’on pouvait déplace toute la population noire loin des States ! […] Certains jours, quand on se promène dans les rues, on croise tellement de Noirs américains qu’on se croirait de retour à Harlem » (p. 20, 22).
Le temps de se trouver une place, Simeon prend de la distance avec ces hommes qu’il ne connaît pas ; et comme il ne vit pas dans les mêmes quartiers et ne fréquente pas les mêmes lieux publics, c’est tout à fait possible. Par contre, il rencontre Maria la Polonaise, avec laquelle il va vivre une histoire d’amour peu banale et qui tente de lui faire accepter « la vie normale », fondée sur l’effacement de la guerre, de l’injustice, de la violence pour ne pas sombrer.
Simeon s’est intégré dans le groupe dont Babe, son premier interlocuteur, est le pivot : il fait, avec lui, sa première expérience « d’homme blanc » : dans un club de la rive gauche, ils sont agressés verbalement par des Américains blancs et le patron met dehors ces derniers gardant Babe et ses amis. Les rôles se sont inversés. Mais manque de chance pour Simeon, en sortant du club, il tombe sur une scène qui le replonge dans le racisme : « Au carrefour, ils virent un policier matraquer un homme. Bien que celui-ci fût déjà tombé sur le trottoir, le flic continuait de le frapper avec sa longue matraque blanche, et l’autre essayait en vain de se protéger la tête avec les bras. L’homme criait dans une langue que Simeon ne comprit pas. Il regarda le passage à tabac jusqu’à ce qu’une voiture de patrouille se gare, que deux policiers embarquent le blessé et que la voiture démarre » (p. 58). Choqué, Simeon écoute sans commentaire l’explication de Babe : « Y a la guerre en Algérie, tu te souviens ? »

C’est au chapitre IV de cette première partie que Simeon se retrouve au cœur du groupe des Algériens (p. 71 à 77). Son ami Harold, musicien, l’emmène dans un café « miteux, rempli d’hommes aux cheveux noirs et bouclés, vêtus d’amples vêtements non repassés », pour écouter de la musique : il a l’air d’y avoir ses habitudes et d’être connu : « Simeon savait qu’il y avait cinq cent mille Algériens en France, mais il n’avait jamais mis les pieds dans leurs cafés ». Dans la rue, en sortant, il vole au secours d’une Hollandaise en train de se faire agressée et frappe l’homme. Il se rend compte alors que l’homme est un Algérien. Les policiers arrivent ; l’homme explique pourquoi il s’en prenait à cette fille. Simeon est d’autant plus dépité que, sous le regard méprisant des Algériens, il n’est pas emmené au poste de police et un policier lui explique la plaie que sont les Arabes et qu’il ne se mêle pas de cela.
L’éducation « politique » de Simeon n’est pas terminée. Il a passé une mauvaise nuit et le lendemain après-midi, il se fait interpellé par un des Algériens de la veille qui va lui poser la question qui le glace : « ça fait quoi d’être un homme blanc ? » (p. 80). L’homme ne lui fait aucun cadeau et le renvoie dans sa bonne conscience de « blanc » : « Ici, c’est nous, les négros ! Tu sais comment les Français nous appellent ? Bicot, melon, raton, nor’af. Ça veut dire « négro » en français. Tu n’as donc pas peur qu’on te vole ? Tu n’es pas dégoûté par nos vêtements non repassés, nos odeurs corporelles ? Non, mais sérieusement, je veux te poser une question sérieuse – tu laisserais ta fille épouser l’un d’entre nous ? » (p. 82). La leçon a été rude et Simeon poursuit son enquête en interrogeant deux étudiants français : l’un nie qu’il y ait du racisme en France ; l’autre est plus lucide. Celui qui nie affirme qu’avec le Arabes, ce n’est pas pareil, « ils sont différents » (p. 88 à 90).
Nous avons suivi ainsi tous les passages où les Algériens et ce qu’ils représentent en France en 1960 sont introduits très progressivement, cohabitant avec le désir contradictoire de Simeon de profiter de cette liberté nouvelle : le roman mène ainsi en parallèle la vie aisée et de plaisir du protagoniste et son regard sur l’Autre absolu qu’est l’Algérien. Et chaque fois, des souvenirs de ce qu’il a subi aux Etats-Unis reviennent avec force, en comparaison, avec, en son centre, le visage des racistes dont il a été la victime.
Dans la seconde partie, « L’homme blanc », le romancier ne se contente pas d’allusions mais introduit des séquences de vie où Simeon ne peut plus être seulement observateur étonné ou compatissant : « L’incident avec les Algériens avait modifié son attitude envers la vie parisienne – il était davantage conscient de la distance qui le séparait des autres Blancs qu’il fréquentait, y compris les Français. Les haines enfouies étaient de retour ; les murs oubliés se dressaient à nouveau entre le monde et lui » (p.94).
Un après-midi où il est attablé à la terrasse d’un café place de la Contrescarpe, un Algérien lui fait signe amicalement de l’intérieur du bar. Ils s’attablent et naît une amitié entre les deux hommes, Simeon et Ahmed. Ce dernier n’a pas approuvé la manière dont Hossein – désormais le romancier appelle les Algériens par leur nom –, a bousculé Simeon et l’a traité d’homme blanc et, en même temps, il explique son attitude. Il ressent une affinité forte avec Simeon, pressentant chez lui un homme qui, comme lui, déteste la violence et le racisme mais n’a pas de haine. Il lui donne aussi des informations sur la lutte des Algériens et le rôle du FLN (p. 110 à 115).
Seconde séquence de « l’éducation algérienne en temps de guerre » de Simeon (p. 115 à 128) : le lendemain, Ahmed l’emmène dans le quartier des Algériens pour manger un couscous : W. Gardner Smith qualifie cette séquence d’« Orphée descendant à Harlem » : au fur et à mesure que le bus monte vers les quartiers nord, Simeon reconnaît Harlem. Ahmed lui donne d’autres informations sur la guerre, les camps, les arrestations arbitraires. Ils arrivent chez Hossein et conversation et repas sont interrompus par une descente de flics musclée. Une fois de plus ces derniers conseillent à Simeon de se tenir à distance, de ne pas se mêler des affaires françaises. Plus tard, lorsqu’il interroge Babe sur son rapport aux Algériens, celui-ci réagit violemment (p. 138). La troisième séquence est tout aussi rude mais cette fois sur « le territoire » de Simeon : il emmène ses amis algériens au Château club. Ils se font mettre dehors et Simeon est déchu de sa qualité de membre (p. 141 à 149). Il y a encore une brève rencontre entre Ahmed et Henri, l’étudiant français conscient du racisme (p. 152). Ahmed en profite pour ouvrir encore les yeux de Simeon sur la réalité de la guerre et la tiédeur du soutien des Français de gauche.
Lou, l’Américain blanc que Simeon préfère, fait une analyse de la chaîne du racisme d’une grande lucidité, engrenage dans lequel les individus se trouvent embarqués. Ils sont rejoints par Hossein, Ben Youcef et Maria (p. 161 à 168). Devant les propos antisémites des deux Algériens qu’Ahmed désapprouve, Maria explose. Il y a un point d’incompréhension douloureux pour Simeon qui, malgré tout, continue sa vie plaisante avec ses amis, non sans mauvaise conscience. Le combat des lycéens de Little Rock et la mort de Patrice Lumumba le bouleversent : « Des images tourbillonnaient, dans son esprit ; les étudiants africains, les Algériens, son frère, Lulu Belle, les manifestants français dans la rue » (p. 203). La vie qu’il mène lui apparaît de plus en plus dérisoire. Cette seconde partie de prise de conscience se clôt sur le départ d’Ahmed (p. 204- 205) : il ne supporte plus sa vie d’étudiant et a décidé de rejoindre la lutte en Algérie : ce départ ébranle fortement Simeon dans son amitié et dans sa décision de fuir l’Amérique.
Alors que la seconde partie était la plus longue, la troisième, « Le frère », est la plus courte. Simeon s’octroie une pause après l’opération des yeux de Maria et passe avec elle deux mois en Corse. Ahmed parti, il ne voit que très rarement des Algériens. Néanmoins, il est sensible au changement d’atmosphère avec les défaites qu’essuie l’Empire français et la rage que cela provoque chez les colonialistes ; la police ne lui semble plus aussi mesurée qu’il le pensait. Des bombes de l’OAS explosent. Simeon essaie d’avoir la vie tranquille que souhaite Maria, « mais il ne pouvait échapper au sentiment de culpabilité chaque fois qu’il lisait le journal ou qu’il croisait des Algériens dans la rue, chaque fois qu’il rencontrait Ben Youcef » : Ahmed est-il mort ? Hossein, sûrement : «Les étrangers – et Simeon avec eux – vivaient dans un monde imaginaire, comme l’écume flottant sur la mer de la société française » (p. 225).
L’avant-dernier chapitre, le chapitre V est celui du retour bref d’Ahmed dont il voit la transformation grâce à son engagement : « Ahmed se tenait très droit, avec fierté, sa peau était bronzée, ses mains autrefois délicates étaient maintenant musclées et calleuses. Ses yeux avaient perdu toute leur timidité juvénile et ils brillaient d’une détermination sereine. Comparé à lui, Simeon eut l’impression d’être un somnambule » (p. 241) Rentré chez lui, Simeon écrit une lettre de rupture à Maria, sentant qu’il doit prendre une décision d’action, poussé par ce que lui a dit Ahmed. Ils se voient tous les jours et Ahmed l’emmène dîner chez Ben Youcef avec deux Algériennes, Djamila et Latifa (p. 246 à 257). Outre le repas, c’est le récit des tortures horribles qu’elles ont subies que racontent les deux hommes à Simeon sans fioritures ni métaphores mais avec des détails précis. Au moment de se quitter, Ahmed l’informe du couvre-feu décrété par la Préfecture de police, uniquement pour les Algériens : « Nous allons les défier ! »
C’est bien l’objet du dernier chapitre : les faits sont d’abord rappelés. Simeon cherche Ahmed ; Babe le met en garde et lui conseille de ne pas être dans la rue. Le romancier donne une description de la manifestation, du nombre, de la diversité des manifestants, des slogans et de la répression. Ici aussi, comme pour l’évocation de la torture, le narrateur ne prend pas de gants et décrit les choses vues. Rappelons qu’il écrit quelques mois après le 17 octobre. Et pendant ce temps, toute la ville continue ses activités habituelles Les corps sont matraqués, certains jetés à la Seine : « Quelques dizaines de mètres devant lui, un policier abattait sa matraque sur une femme qui tenait un bébé. Elle tomba à genoux, se pencha en avant pour protéger son enfant, mais la matraque du policier s’abattait encore et encore et encore. Simeon regarda, comprit qu’il pleurait, sentit tous ces coups sur son propre corps. Brusquement, il découvrit le visage du policier […] c’était Chris, Mike, leur visage. Les traits du flic étaient déformés, tordus par la joie de la destruction, ses yeux rétrécis, des taches rouges d’excitation constellaient sa peau d’une pâleur mortelle » (p. 262).
Simeon fonce sur le flic et lui balance un coup de poing de toutes ses forces. Quand il se réveille, il est entassé avec d’autres dans un fourgon. On les fait tous rentrer dans un stade à coups de poings et de matraques. C’est là qu’un homme le salue : « Salut, frère ! ». Une fois de plus, son origine américaine le sort du troupeau et le policier qui le libère lui fait la leçon : « Nous aimons les nègres ici, vous savez, nous ne pratiquons pas le racisme en France, ce n’est pas comme aux États-Unis. Nous pouvons comprendre pourquoi vous préférez vivre ici. Nous n’aimerions pas être contraints de vous expulser » (p. 268). En quelques jours, Simeon dit adieu à sa vie parisienne et décide de retourner en Amérique.
Ce roman équilibré et touchant, frappe par sa mesure et sa vérité. Traduit en 1963-1964, aurait-il touché un public français meurtri par la perte de l’Algérie ? Peut-être que non. Et pourtant, il confirme bien ce que Pierre Barbéris a analysé dans les rapports de l’Histoire et du texte littéraire : « À certains moments, dans certaines conditions, parce qu’il est beaucoup moins compromis idéologiquement que le texte historique, parce qu’il est un moyen de transgression de l’idéologie dominante, c’est lui qui donne une image plus adéquate de la réalité ; c’est lui qui» travaille » mieux la réalité et la donne à connaître ». William Gardner Smith ne fait pas allusion au 17 octobre de façon périphérique et anecdotique : il l’intègre dans l’évolution de son personnage. Il est un aboutissement du ferment qu’a été pour lui son regard sur les Algériens en ces années 1960-1961, comment les amitiés créées sur la base d’un désir de justice aident le jeune homme à regarder autrement son vécu. Ce regard qui n’est ni français ni algérien acquiert de ce fait une intensité que le refus de traduction avait bien perçu comme un danger de témoignage et d’objectivité.
James Baldwin, Chassés de la lumière
Sept ans après Le Visage de pierre de William Gardner Smith , James Baldwin se faisait à son tour l’écho de la condition des Algériens en France dans ses « Souvenirs de Paris, 1948-1952 » dans No name in the street (1971), traduit chez Stock l’année suivante sous le titre Chassés de la lumière. C’est là un autre regard afro-américain sur les Algériens. James Baldwin rappelle son arrivée à Paris en 1948 : comme il n’avait pas d’argent, il vivait « parmi les misérables et, à Paris, les misérables sont algériens ». Il décrit leur mode de vie peu enviable, « traités comme des bêtes », « sur le pavé sale et hostile de Paris ». Les Français avec lesquels il discute, les accusent de tous les maux : paresseux, voleurs, violeurs. Pour James Baldwin, c’est un refrain connu !… Il explique leur présence dans les cafés par un besoin de chaleur pour échapper au froid glacial des chambres et pousse plus loin son analyse : « Les Français étaient encore enlisés dans la guerre d’Indochine quand j’arrivai en France et je vivais à Paris quand Dien Bien Phu tomba. Les marchands de tapis et de cacahuètes qui arpentaient les rues de Paris n’avaient rien à voir alors avec ce désastre militaire ; pourtant, l’attitude populaire, qui n’avait jamais été très amicale, et celle de la police, qui avait toujours été menaçante, se firent plus sournoises et méchantes. […] Les Arabes ne faisaient pas partie de l’Indochine mais ils faisaient partie d’un empire qui, visiblement, s’écroulait à toute allure, partie d’une histoire qui arrivait à son dénouement (au sens littéral et douloureux du mot) et se révélait le contraire du mythe que les Français en avaient fait ».
Aussi les Français ne supportent pas qu’on critique l’œuvre de la France en Algérie qui a apporté la civilisation : « On me disait, avec un sourire chaleureux, que j’étais différent : le Noir américain est très évolué, voyons ! Les Arabes, non ; ils n’étaient pas « civilisés » comme moi. […] Mais les Français supportaient ça avec patience depuis cent ans et étaient prêts à continuer ainsi pendant aussi longtemps bien que l’Algérie fût un lourd fardeau pour l’économie nationale. […] Bref, la générosité des Français était si constante et exemplaire qu’il était impossible d’imaginer ses enfants prêts à se révolter ».
James Baldwin n’est pas dupe car il sait regarder : « Un après-midi ensoleillé, j’avais vu dans la rue, la police rouer de coups un vieux vendeur de cacahuètes qui n’avait qu’un bras et j’avais vu aussi les visages indifférents des Français assis à la terrasse d’un café et ceux des Arabes gonflés de haine. […] Et la révolte arriva. Non sans signes avant-coureurs, sans avertissements. Mais seuls les poètes, dont le travail est d’exhumer et de recréer l’histoire, savent déchiffrer ces messages là. Après quatre années à l’étranger, je retournai à New York en 1952 […] ».
Didier Daeninckx, Meurtres pour mémoire
En 1984, vingt ans après le roman américain et vingt-cinq ans après l’événement, paraît le premier roman français sur le 17 octobre 1961 ; il reçut le grand prix de la littérature policière en 1985. Celui qui a osé, avec courage et conviction, lever la chape de plomb qui écrasait l’événement, ne connaissait pas The Stone face. Il a travaillé sur des archives. Ce roman policier s’intitule Meurtres pour mémoire. Une enquête de l’inspecteur Cadin ; il paraît chez Gallimard. On peut mettre en parallèle le titre du livre et son l’exergue : « En oubliant le passé/On se condamne à le revivre » car le silence sur le 17 octobre est véritablement l’anéantissement de la mémoire.
Le romancier choisit de camper des personnages précis, sortant « les Algériens » ou « les Arabes » de l’anonymat qui accompagne habituellement leur mention. Le chapitre I plonge le lecteur dans les préparatifs d’une manifestation en suivant Saïd Milache, ouvrier imprimeur, qui quitte son travail pour se rendre à la manif. Le texte note : « À dix neuf heures vingt cinq, le mardi 17 octobre 1961, Saïd Milache et Lounès Tougourd montaient les marches du métro Bonne-Nouvelle ».
Le personnage suivant est un Français, Roger Thiraud, professeur d’Histoire qui va voir un film. Avant de rentrer chez lui, « il regarda machinalement vers le métro, ainsi qu’il faisait quelques années auparavant en attendant Muriel. Deux Algériens, col relevé pour s’abriter du vent, apparurent au même instant. La montre de Roger Thiraud marquait dix-neuf heures vingt cinq, le mardi 17 octobre 1961 ».
Kaïra Guelanine est le troisième personnage : elle vit avec son père et ses frères et sœurs au bidonville de Nanterre et est engagée dans la résistance ; elle est l’une des organisatrices de la manifestation. Son frère l’emmène en moto rejoindre Saïd : « À la devanture de la bijouterie qui faisait l’angle de la rue Notre-Dame-de-Bonne Nouvelle, une imposante horloge marquait dix-neuf heures vingt-cinq. Le 17 octobre 1961 ».
Le chapitre II est consacré à la manifestation elle-même : « au coup de sifflet strident », les manifestants sortent de partout et se mettent en ordre de marche ; « un millier d’Algériens bloquaient le carrefour Bonne-Nouvelle » aux cris de « Algérie algérienne ». Roger Thiraud observe, admiratif, « ils avaient osé ! » Il est en décalage par rapport aux autres Français qui disent plutôt : « J’espère que l’armée va rappliquer pour me virer tous ces fellouzes ». Saïd et ses amis sont là, Aounit, le frère de Kaïra aussi : en face, les CRS qui ont des consignes précises : « Brisez le mouvement, n’hésitez pas à vous servir de vos armes si la situation l’exige. Chaque homme est fondé à juger, en cas d’engagement physique, du moyen de riposte approprié ».
Le romancier décrit, avec force détails, la charge brutale des CRS et note qu’« il était près de huit heures ». La répression a été ultra rapide : moins de 30 mn puisque le romancier avait noté l’heure d’arrivée des manifestants au point de ralliement. Tous ceux qu’il a cités sont morts ou arrêtés. En une demi-heure, c’est le carnage contre des manifestants pacifiques et sans aucune négociation. Roger Thiraud a tout observé, horrifié. Il n’est pas intervenu. Un homme l’observe et le tue. « Au petit matin il ne restait plus sur les boulevards que des milliers de chaussures, d’objets, de débris divers qui témoignaient de la violence des affrontements. Le silence s’était établi, enfin. Une équipe de secours envoyée par la Préfecture de Police recherchait les blessés et les cadavres. On ne s’embarrassait pas de gestes inutiles, ni de problèmes de conscience, les corps étaient entassés pêle-mêle, sans distinction ». Ce massacre en plein Paris n’a que peu d’échos dans la presse du lendemain, ni récit, ni photos… « circulez, il n’y a rien à voir ».
Vingt-cinq pages pour raconter cette soirée et cette nuit terribles : comment le roman va-t-il rebondir ? Au chapitre III, on apprend que l’inspecteur Cadin mène l’enquête vingt ans plus tard quand le fils de Roger Thiraud est assassiné aussi mystérieusement que son père, mais à Toulouse. Quel lien ? Il ne peut croire à un hasard et cherche dans la vie du père ce qui aurait provoqué son élimination. Il a toutes les difficultés car le 17 octobre est passé dans les trappes de l’Histoire. Le collègue policier que Cadin voit à Paris l’exhorte à laisser tomber : dès qu’il s’agit de la guerre d’Algérie, il vaut mieux être prudent, il ne faut pas réveiller le passé. Le dossier est classé « sans suite ». La version officielle à laquelle il faut se tenir a été ainsi formulée au plus haut sommet de l’État : « La police parisienne avait répondu à sa mission, en protégeant la capitale d’une émeute déclenchée par une organisation terroriste ». Au cours de l’enquête, Cadin rencontre Marc Roser, le seul photographe dont on n’a pas voulu publier les photos. Ses souvenirs sont bien précis : « Les Algériens en ont pris plein la gueule ». Il décrit tout : les CRS et autres armés jusqu’aux dents et chauffés à blanc pour en découdre ; les morts, les embarqués dans les caves, les fourgons, les noyés.
Après ce passage, le 17 octobre ne revient pas dans le roman. L’événement couvre à peu près une trentaine de pages sur les 196 du roman. Mais sa position initiale est essentielle : on sait combien l’ouverture d’un roman est déterminante pour la suite de la lecture. Le 17 octobre est, en quelque sorte, l’écran, au premier plan, sur lequel Daeninckx projette les agissements meurtriers d’un pouvoir policier soutenu au plus haut niveau– on note qu’il ne donne aucun nom mais les dates suffisent –, et la pérennisation des protections déployées pour l’impunité des acteurs. Derrière le 17 octobre s’ouvre une enquête sur la déportation des juifs en France qui est mise progressivement à jour et la raison de l’assassinat du père et du fils qui ont mis le nez là où il ne le fallait pas. En 1984, quand personne n’osait réveiller les responsabilités de cette répression – à six mois des accords d’Évian – ce roman policier impose une dénonciation courageuse en s’appuyant sur « un prologue » lié à la suite du roman, deux épisodes peu reluisants de l’Histoire française récente.
Didier Daeninckx avait d’abord pensé s’appuyer sur l’affaire du métro Charonne, le 8 février 1962 et a finalement opté pour le 17 octobre 1961. Les deux répressions ont été dirigées par Maurice Papon. Notons qu’en 1999 (Maurice Papon a été condamné en avril 1998 mais pas pour ses répressions contre les Algériens), Leïla Sebbar publie un court roman, La Seine était rouge. Est privilégié le point de vue d’une jeune fille, Amel, porteuse des motifs préférés de la romancière dans ses autres écrits : l’absence de transmission des parents aux enfants, la méconnaissance de l’arabe et de l’islam, la distance de la voix de la narration par rapport à l’Algérie-nation. Les témoins du 17 octobre convoqués ne sont pas, dans la majorité des cas, des militants convaincus de la cause indépendantiste mais soit ses opposants, soit ses suiveurs sans conviction. L’événement est bien rapporté mais vidé de flamme et de conviction.
En 2019, le 17 octobre intervient en finale du roman policier de Thomas Cantaloube, Requiem pour une République, comme une turpitude de plus sur la Ve République et ses serviteurs. Le roman embrasse les années 59-61 ; il nomme des acteurs connus et certains encore vivants et monte une intrigue captivante autour de l’assassinat d’un avocat algérien lié au FLN et de toute sa famille, assassinat qui vire au carnage, à l’automne 1959. Un trio est lancé sur l’enquête par les forces en présence : « Sirius Volkstrom, ancien collabo, manchot devenu exécuteur de basses œuvres pour Papon, Antoine Carrega, ancien résistant corse devenu convoyeur de drogue et Luc Blanchard, jeune policier assez naïf. Ces trois individus que tout oppose vont se croiser et devoir, malgré eux, œuvrer ensemble pour déjouer cette importante manipulation politique ». Le 17 octobre n’est pas traité en lui-même mais comme une preuve de plus des embrouilles sanglantes du pouvoir.
Dans Poétiques de l’événement, Sabrina Parent écrit qu’« un fait peut être appréhendé commeévénement dans la mesure où « “ce qui arrive” bouleverse un horizon d’attente, laissant celui à qui l’événement arrive dans l’expectative d’un sens à venir ». Elle précise que le lieu privilégié de l’événement est la narration. Les récits littéraires que nous venons de rappeler, les deux premiers en particulier, peuvent avoir bouleversé un horizon d’attente et elles sont susceptibles de provoquer un autre éclairage de l’Histoire.
William Gardner Smith, Le visage de pierre, traduit de l’anglais (États-Unis) par Brice Mathieussent, Christian Bourgois éditeur, octobre 2021, 273 p., 21 €