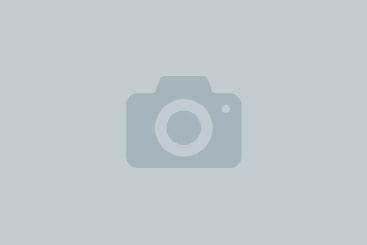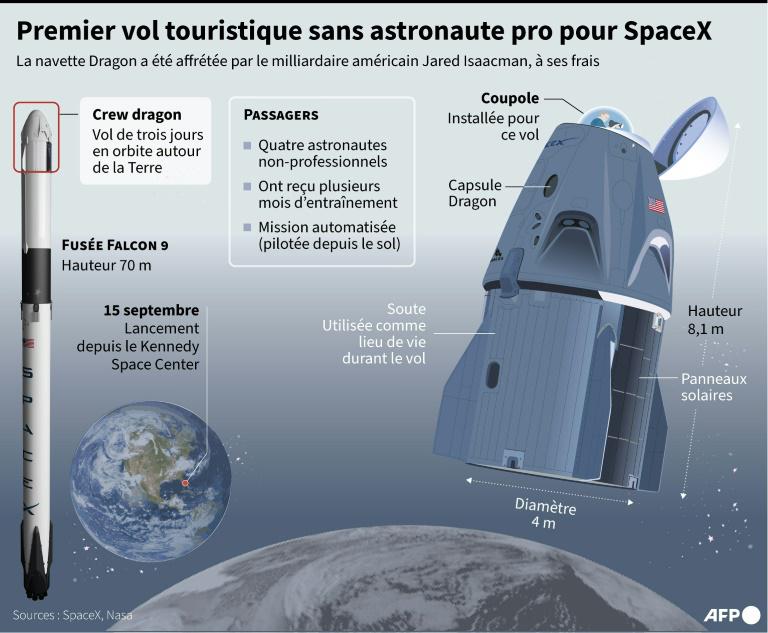Décès de l'Espagnol Ricardo Bofill, grand de l’architecture
Superstar de l’architecture, adoré ou critiqué, Ricardo Bofill est décédé vendredi de complications liées au Covid-19, à 82 ans. Né à Barcelone d'un père architecte catalan et d'une mère vénitienne, Ricardo Bofill Levi entre en 1957 à l'Ecole d'architecture de la ville, d'où il est exclu pour militantisme anti-franquiste, avant de poursuivre ses études à Genève. De retour dans sa ville natale, dans une Espagne toujours sous la coupe du dictateur Francisco Franco, il fait partie avec d'autres jeunes intellectuels (architectes, ingénieurs, écrivains, cinéastes, sociologues et philosophes) d'un groupe baptisé la "Gauche divine" et crée en 1963 son atelier d'architecture, le "Taller de Arquitectura".
Cet atelier, installé dans une vieille cimenterie de la périphérie de Barcelone, avec des antennes à Paris, Montpellier, New York, Tokyo, Chicago ou Pékin, a signé plus de 1000 projets dans le monde entier. On doit notamment à son atelier l'aéroport de Barcelone, l'hôtel W de la plage de Barceloneta, le Théâtre national de Catalogne, le Palais des Congrès à Madrid ou les gratte-ciel Donnelley et Dearborn à Chicago. En France, où il est particulièrement apprécié, Bofill a signé plusieurs grands ensembles : à Paris, la place de Catalogne (14ème) et le marché Saint-Honoré (1er) ; le quartier Antigone à Montpellier ; mais surtout les Espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand (où ont été tournées des scènes de "Brazil" de Terry Gilliam en 1985, et de “Hunger Games 2”)
Fait docteur honoris causa par l'Université polytechnique de Catalogne en septembre dernier, Bofill avait alors souligné que "face au modèle de ville dortoir", il avait fait "le pari de créer des quartiers avec des fonctions mêlées, mais toujours en défendant la continuité urbaine, la rue et la place" comme lieu de vie sociale. A un moment où, aux Etats-Unis en particulier, les centre-villes disparaissaient pour laisser la place à la voiture et à des centres commerciaux.
En 1988, Ricardo Bofill s’était confié à notre magazine sur son œuvre. Voici l’interview telle que publiée dans Paris Match à l’époque.
Découvrez Rétro Match, l'actualité à travers les archives de Match...
ERRATUM :Une première version de cet article attribuait, à tort, les Arènes de Picasso de Noisy-le-Grand à Ricardo Bofill. L'ensemble est en réalité l’oeuvre de l’architecte Manuel Nuñez Yanowsky, co-fondateur avec Ricardo Bofill de "Taller de Arquitectura", avant son départ en 1978. Le texte a été corrigé. Nos excuses à nos lecteurs comme aux personnes concernées.
Paris Match n°2037, 10 juin 1988
Ricardo Bofill, le conquistador de l’architecture
Par Philippe Trétiack
De Montpellier à Houston, ce dandy catalan se transforme en bâtisseur planétaire mais son style néo-classique et son sens médiatique irritent souvent ses confrères. Il contre-attaque dans Paris Match.
Son nom est un des symboles de l'architecture d'aujourd'hui. Et, même si le grand public le connaît moins bien, Ricardo Bofill est bien une star, au même titre que Herbert von Karajan ou Alain Prost. C'est qu'il y a du chef d'orchestre et du champion solitaire chez ce Catalan amoureux de la France, qui cultive le don du commandement, le sens du travail d'équipe, la fougue du sprinter et l'acharnement du coureur de fond. Autant de qualités qui lui valent nombre de commandes mais aussi beaucoup d'inimitiés. Avec son éternelle chemise blanche, ce bâtisseur virevoltant agace souvent des confrères moroses qui, frappés de plein fouet par la crise, n'apprécient pas toujours son sens médiatique.
Quoi qu'il en soit, le style Bofill existe, nous l'avons tous rencontré. Pâles répliques du passé, faux Versailles pour les uns, grandioses palais pour le peuple selon les autres, les réalisations du Taller de Arquitectura, l'agence de Ricardo Bofill, s'imposent. Et on l'imite, ce qui est la marque des grands architectes. Ainsi, de la colonnade du lac de Cergy-Pontoise, aux H.l.m. de la gare Montparnasse en passant par le fameux immeuble du Théâtre de Marne-la-Vallée, Bofill s'est construit une réputation néo-classique en France, avant de partir à la conquête du monde.

Aujourd'hui, Ricardo Bofill, conquistador et chef de bande, dirige une véritable multinationale de l'architecture. Ses bâtiments s'élèvent à Montpellier, Bordeaux, mais encore à Stockholm, à Bruxelles, et bientôt à Moscou, New York, Houston, Buenos Aires, Toronto... Partout, le « classicisme moderne » dont il se réclame gagne du terrain. Oui, on est décidément très loin du mythique architecte bohème, enroulé dans son écharpe. Dans les locaux du Taller, plusieurs étages de somptueux bureaux à moulures et pâtisseries, situés au cœur de Paris, rue de l'Université, Ricardo règne en maître, sanglé dans un strict costume de banquier à rayures bleues qu'il porte un petit peu trop serré. Comme un toréador.
Paris Match. Vous construisez dans le monde entier. Vous brassez énormément d'affaires. Avez-vous encore le temps d'être un architecte ?Ricardo Bofill. Je m'occupe de tous mes projets. Cela m'oblige à circuler beaucoup. Je passe dix jours par mois à Paris, dix autres à Barcelone, et le reste en avion ou à New York. Au départ, nous acceptons des commandes, nous gagnons des concours ou même nous suscitons des réalisations. Ensuite, et c'est la première phase, je vais à Barcelone déterminer le "parti" (le concept) du projet. Je le fais soit par écrit soit à l'aide de dessins d'idées toujours géométriques, jamais détaillés. Après, je confie le dossier à mes collaborateurs, et je le retravaille avec eux tous les mois. Ils me téléphonent, ils me disent : “Là, Ricardo, tu te trompes. Il faudrait faire ceci ou cela..." On discute.
Parlons un peu de votre style. On vous a beaucoup reproché votre côté rétro, « mussolinien ». Qu'en pensez-vous ? Je crois que la mode a beaucoup trop d'importance dans ce pays. Ce côté "fashion" est terrible. Je préfère l'attitude anglaise qui consiste à s'habiller avec les vêtements de ses grands-parents et de trouver ça très bien. Les gens pour qui une colonne, c'est du fascisme, sont les mêmes pour qui toutes les œuvres de musique classique se ressemblent. En vérité, on m'a reproché des choses sans savoir, parce qu'aucun architecte n'a produit autant de styles différents que moi. Je suis le plus éclectique de tous.
Ce n'est pas l'image qu'on a de vous ici. Pour nous, vous êtes l'homme des colonnades classiques. Et pourtant ! Pendant dix ans, je me suis imposé un travail dingue, faire du logement social digne, prouver que les pauvres pouvaient habiter dans des bâtiments aussi beaux que ceux des riches. Mais, en France, on ne le sait pas. Ce qui est terrible de toute manière, c'est cette notion de la France et du reste du monde. Mais, la planète n'est pas structurée comme ça. Il n'y a pas la France et le reste du monde ; il y a les Etats-Unis, l'Angleterre, le Maroc…
Alors comment êtes-vous considéré ailleurs ? Aux Etats-Unis, comme l'architecte européen designer élégant. En Russie, comme un constructeur d'usines de préfabrication. En Belgique, comme un visionnaire et un philosophe : et en Espagne, comme un personnage étrange et pénétrant... Mais, en France, je suis l'architecte du logement social néoclassique. C'est comme ça. Les gens ont vite fait de me classer. Or, moi, je n'aime pas les classifications. Mais, j'ai, de toute façon, une immense gratitude envers la France. Je n'aurais jamais pu faire à l'étranger ce que je vais réaliser par exemple à Montpellier. Même en Espagne, c'est impossible. Là-bas, 30% de la construction se fait au noir !
Quelles sont vos sources d'inspiration ?Chez moi, la création est une maladie. Je dessine un projet toutes les deux semaines. Pour cela, je m'inspire des espaces vides, des rochers du désert, des temples grecs de Sicile, de l'architecture populaire espagnole. De quelques architectes aussi, Alvar Aalto, Gaudi, Ledoux, Palladio. Lentement, je suis passé d'une architecture subjective, qui me plaisait, à une architecture pour les autres, de Dostoïevski à Tolstoi. Et puis, la musique. Pendant des années, j'ai écouté "Norma" douze heures par jour. Actuellement, j'ai une passion pour un pianiste yougoslave qui s'appelle Ivo Pogorelich.
Qu'est-ce que vous détestez, aimez dans la vie ? Je hais tout ce qui est faux. Le faux luxe, le folklore, les copies, le manque d'invention. Le paternalisme qui consiste à donner aux gens ce que l'on croit qu'ils attendent. Le confort petit bourgeois. J'aime la qualité, la performance, le talent, le génie, ceux qui vous font vibrer, qui créent des émotions. J'aime Alain Prost quand il gagne le Championnat du monde parce qu'il a volé un dixième de seconde. Ce petit plus qui fait toute la différence, comme en tauromachie. J'aime Bertolucci quand il fait un film grand public mais de qualité. J'aime Placido Domingo quand il chante devant 300 000 personnes à Madrid, je n'aime pas Julio Iglesias quand il chante devant 300 000 personnes à Madrid.
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'un architecte ? Ce que je sais, c'est que pour réussir, il m'a fallu combattre cette notion de l'architecte du prince, éternel "employé" du pouvoir. J'ai dû me battre pour expliquer qu'un architecte moderne devait savoir croiser la technologie et le management. L'architecte n'est plus un type qui fait des plans dans un café ! En Espagne, il y a plein de maires de villes qui sont architectes. Pourquoi pas en France ? Dans notre profession, nous devons nous intéresser à tout : à l'urbanisme, à la politique et au coût des choses. Il faut comprendre les rouages d'une société pour pouvoir s'y implanter. On ne travaille pas de la même façon en France et en U.r.s.s. Pourtant, et malgré tous ces aspects, l'architecture reste pour moi un Art avec un grand A. L'art majeur, celui de l'anticipation, celui qui, en traitant de l'espace, influe sur tous les autres, la peinture, la sculpture...
Et comment cet art avec un grand A va-t-il évoluer ?Au Taller, nous avons deux objectifs. Le premier pour 1992, c'est un développement EstOuest. Jusqu'à ces dernières années, nous avions travaillé en fonction d'un axe Nord-Sud, du Sahara à la Suède. Nous allons nous redéployer de l'U.r.s.s. à la Californie. L'autre objectif, pour l'an 2000, est un pari sur l'architecture. Aujourd'hui, dans le monde, il ne reste, en fait, que deux vraies tendances. Il y a celle que je représente et que l'on peut appeler le classicisme moderne : c'est la réutilisation d'éléments structurels de l'architecture traditionnelle (colonnes, frontons...) dans des programmes qui tiennent compte des innovations technologiques et sociales... Et puis l'architecture high-tech dont les leaders sont Piano et Rogers, les architectes de Beaubourg ou encore Norman Foster, l'homme de la banque de Hong-kong. Au Taller, nous allons tenter de croiser ces deux tendances. Pour cela, nous allons travailler avec les meilleurs ingénieurs anglais pour arriver à lier les questions de proportions, de sociabilité mais aussi de rentabilité avec la plus haute technologie de pointe. Nous le faisons déjà pour la tour de la Communication de Barcelone où nous avons fait appel aux ingénieurs français qui fabriquent les plates-formes de forage en mer.
Avez-vous un grand projet pour Paris ?Bien sûr, car c'est la plus belle ville du monde, en tout cas du point de vue urbain. Depuis quelques années, toutes les grandes opérations que l'on y mène sont des musées. Je crois que si la France veut conserver une place importante dans le monde, il faut que Paris se dote comme Londres ou Francfort de la place financière qui lui manque. Sinon, elle ne sera plus qu'une belle ville de collections, comme Florence, sans réel poids économique et politique. Justement, moi, j'ai un projet de ce type. Il faudrait qu'une cité financière soit édifiée en bordure de la Seine. Je ne peux pas dire exactement où, mais j'ai déjà une idée de l'emplacement idéal. Mais, pour l'instant, je me concentre sur Barcelone : le Taller y construit un hôtel, le Théâtre de Catalogne, l'université des sports, le nouvel aéroport et nous repensons le centre ville...
Etes-vous riche ?A New York, on dit que l'on est riche quand on possède 100 millions de dollars en banque. Alors non, je ne suis pas riche. D'ailleurs, je ne collectionne rien, je n'ai pas de tableaux, je veux posséder le moins de choses personnelles possible. Tout ce que je veux, c'est avoir la potentialité financière pour réaliser des choses de plus en plus importantes. Cela signifie que je veux m'implanter en réseaux partout. La seule chose que je rêve de posséder, c'est un jet privé. Car je perds trop de temps dans les aéroports. L'architecte anglais Norman Foster a, lui, un avion et un hélicoptère personnel. Là, je suis un peu jaloux. - Toujours plus vite...
Etes-vous un drogué du travail ?Certainement. J'ai pensé toute ma vie que je n'en faisais pas assez par rapport à mes capacités. Aujourd'hui, j'estime travailler à 60/70 % de mes moyens. Mais, c'est vrai que je suis plutôt un “speedé". Ce que j'apprécie de plus en plus, c'est d'être obligé de changer de vitesse en passant d'un pays ou d'un projet à l'autre. Et puis, je profite mieux des arrêts brusques. J'aime les contradictions, les tensions de ruptures, le rythme frénétique et, d'un seul coup, le dolce farniente. Parfois, je pars dans le désert à la frontière du Niger et je ne vois plus qu'une ligne autour de moi. C'est là que je me sens le mieux.
Portez-vous toujours des chemises blanches ? Oui et de plus en plus. Je m'habille comme les paysans espagnols d'autrefois qui travaillaient en ocre et mettaient du blanc le dimanche. Pour moi, c'est tous les jours dimanche.
Pour toute question sur nos photos, anciens numéros et hors-séries, consultez nos services...
Toute reproduction interdite