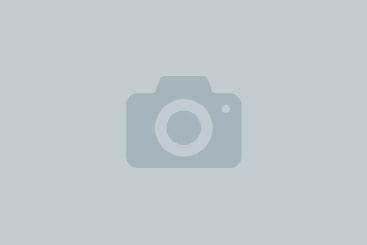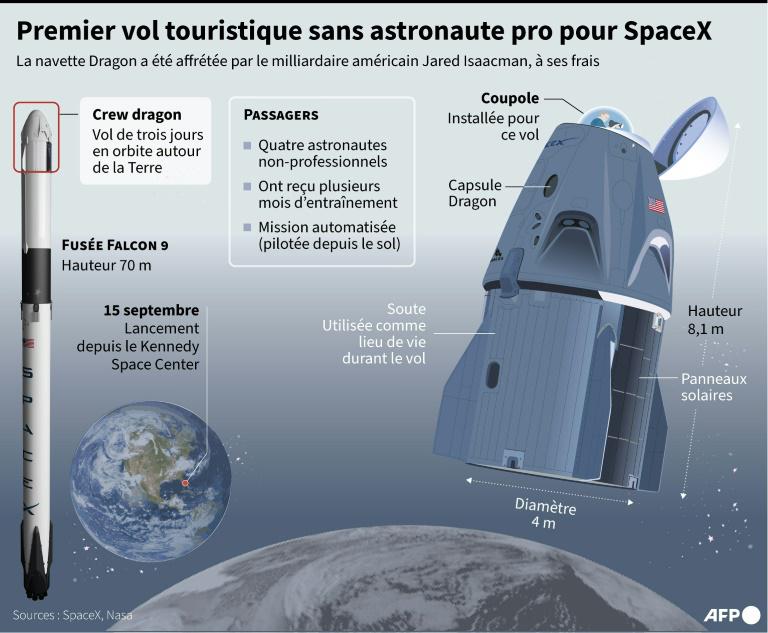Les Soviétiques en quête de bons plans
«Planification ». L’expression a longtemps évoqué au pire la famine, au mieux de longues files de chalands s’étirant devant des magasins vides… La pandémie mondiale de Covid-19 offrirait-elle à cet outil disqualifié une cure de jouvence inattendue ? Nationalisations, plans de relance colossaux, suspensions du versement des dividendes : nombre de dirigeants politiques, dont les plus libéraux, placent subitement l’État au cœur de la mobilisation économique générale. L’économie soviétique n’a pas cessé pour autant de servir de repoussoir. À la fois autoritaire, productiviste et inefficace, elle incarnerait l’antimodèle, sans qu’on prenne la peine d’en reconnaître les succès ou de replacer ses difficultés dans le contexte de l’époque. Toutefois, alors que l’urgence climatique suggère de mettre l’économie au service d’autres fins que le profit, c’est précisément cette expérience qui a poussé le plus loin le volontarisme politique en matière économique.
Le modèle soviétique dégage les moyens de production de la propriété privée. Celle-ci dirigerait les ressources vers des productions et des branches qu’elle espère lucratives, au lieu de se consacrer à la satisfaction des besoins sociaux et des priorités nationales. L’ambition du plan est de substituer les calculs de l’ingénieur-planificateur aux mouvements chaotiques de la concurrence. Toutes les entreprises, de l’usine métallurgique à la ferme collective, sont administrativement rattachées à une branche de l’économie que chapeaute un commissariat, plus tard renommé ministère. Le plan annuel fait force de loi. Il donne les quantités qu’il faut produire pour chaque type de bien. Cet effort est ensuite distribué entre chaque branche de l’économie puis décomposé au niveau de chaque entreprise. En pratique, l’élaboration du plan nécessite un échange d’informations permanent entre le centre planificateur (Gosplan) et les directions d’entreprise, via les ministères de branche. Le Gosplan doit s’assurer que les approvisionnements promis aux entreprises, qui font remonter leurs besoins, correspondent à la production planifiée. C’est l’équilibrage dit des « balances-matières ».
Industrialisation à marche forcée
Les prix des biens sont quasiment tous administrés. Pour les salaires, il existe certes des références conventionnelles, mais les entreprises ont la possibilité de moduler les rémunérations par le jeu des primes ou des quotas de production. Néanmoins, la masse salariale globale est, quant à elle, fixée au préalable chaque année par le ministère de tutelle (qui reçoit lui-même une dotation du Gosplan). Ainsi, dans une entreprise soviétique, le « bénéfice » — la différence entre le prix de vente du produit et le coût de production — prend la forme d’un surplus (ou d’un déficit), lui aussi calculé par avance. Il a vocation à « remonter » vers le centre, qui effectue l’essentiel des investissements. Le système de prix renferme un mécanisme de subventions forcées des branches excédentaires vers les branches déficitaires de l’économie, permettant d’injecter de grandes quantités de ressources dans des secteurs prioritaires, en dehors de tout critère de rentabilité.
Dans les faits, la planification n’intervient qu’en 1928, une fois la guerre civile gagnée et les possédants expropriés. Mais elle n’a rien d’un programme calculé par de savants économistes : c’est la guerre, soit la menace d’un conflit armé majeur avec les puissances capitalistes, qui impose cette méthode et surtout son objectif, celui d’une industrialisation à marche forcée. « Considérant la possibilité d’une attaque militaire (…), il est essentiel, en élaborant le plan quinquennal, de consacrer une attention extrême au développement aussi rapide que possible des branches de l’économie en général et de l’industrie en particulier, qui joueront le premier rôle dans la défense et la stabilité économique du pays en temps de guerre », affirme le XVe Congrès du Parti, en 1927.
Dans un pays coupé des capitaux étrangers, diplomatiquement isolé et essentiellement rural, les ressources ne peuvent provenir que de la paysannerie. L’industrialisation rapide suppose que les paysans quittent massivement les campagnes, en conservant la possibilité de nourrir la population. Or, à l’époque, les paysans russes autoconsomment une grande partie de leur production. Ils n’atteignent les faubourgs des villes qu’au compte-gouttes et échappent en grande partie à l’impôt. En lançant la collectivisation, les autorités soviétiques ont cherché à briser l’autarcie paysanne. Les paysans résistent : entre 1929 et 1933, ils préfèrent abattre leur bétail et réduire les surfaces ensemencées plutôt que de livrer leur production à vil prix, ce qui provoque une famine terrible. Joseph Staline réagit en durcissant les réquisitions et fait déporter les paysans récalcitrants. Sous cette pression maximale, le surplus agricole vendu double entre 1928 et 1937. « De manière perverse, admet l’économiste Robert C. Allen, la collectivisation a accéléré l’industrialisation, en expulsant la population des campagnes. Sans collectivisation, la migration campagne-ville aurait été moins intense, les villes plus petites, la production industrielle plus faible. »
En dépit de millions de victimes, les résultats sont, si l’on peut dire, au rendez-vous. Dans la décennie qui suit le lancement du premier plan quinquennal (1929-1933), la production soviétique est multipliée par 1,5 (contre 1,1 en Europe de l’Ouest). Au même moment, les économies caractérisées, comme en Russie, par le poids écrasant de la paysannerie (environ trois quarts de la population) stagnent ou plongent dans le sous-développement (cône sud de l’Amérique latine, Asie du Sud-Est, Proche-Orient) sous l’effet d’une mondialisation déjà très inégalitaire. En 1941, lorsque l’« attaque militaire » redoutée aura lieu, l’URSS dispose des bases industrielles suffisantes pour organiser une contre-attaque, et inflige sa première défaite à l’Allemagne nazie à Stalingrad.
La forme violente qu’a prise l’industrialisation soviétique tient davantage à son rythme accéléré qu’à la méthode planificatrice elle-même. D’ailleurs, celle-ci balbutie encore dans les années 1930. Comme le rappelle l’historien Eric Hobsbawm, l’économie soviétique présente alors un fonctionnement « plus proche d’une opération militaire que d’une entreprise économique ». La discipline la plus stricte côtoie le plus grand désordre. « Par définition, ce système fixe des priorités et décrète la mobilisation générale, écrit-il. Par la suite, les urgences ont tendance à s’additionner et, du coup, à s’entre-annuler, laissant les acteurs économiques se débrouiller pour les hiérarchiser. Par nature, le systèmefonctionne par “chocs” presque institutionnalisés : fixer des objectifs irréalistes pour encourager des effortssurhumains (1). »

Dans ce contexte, les calculs économiques jouent un rôle moins décisif que les mots d’ordre politiques. Car le système produisait des enthousiasmes sincères, sans lesquels il n’aurait certainement pas survécu. Il ouvrait aux classes populaires, massivement scolarisées, des perspectives de mobilité sociale qu’elles n’avaient jamais entrevues. En pleine guerre civile, le nombre de jeunes pris en charge par l’école passe de 3,5 à 5 millions. Dans les années 1930, l’illettrisme recule fortement, passant de 50 % à 20 % de la population adulte, essentiellement au profit des femmes (2).
Les circonstances historiques ont obligé les dirigeants soviétiques à produire en masse hauts-fourneaux et chars d’assaut. Mais les autorités se sont très tôt préoccupées de la consommation. Quels besoins sociaux fallait-il couvrir ? En était-on seulement capable ? Si tel n’était pas le cas, comment gérer la pénurie pour en limiter les effets politiques ? Fallait-il partir des comportements de consommation actuels ou en façonner de nouveaux ? Quelle part attribuer au strict nécessaire, ou au simplement utile, ou à l’agréable ? Enfin, comment expliquer et réduire l’écart entre la réalité, souvent cruellement déficitaire et inégalitaire, et l’idéal poursuivi ?
Quels besoins sociaux couvrir ?
Ces dilemmes sont particulièrement prégnants dans le secteur de la mode (3). Dans le feu de la guerre civile, les bolcheviks prônent l’ascétisme révolutionnaire jusqu’en matière de vêtements. Il s’agit de s’opposer à la mode bourgeoise, qui susciterait chez les consommateurs le besoin artificiel de renouveler sans cesse sa garde-robe. Mais le pragmatisme exige que certains soient plus ascétiques que d’autres… Jusqu’au milieu des années 1930, puis à nouveau durant la seconde guerre mondiale, un système de rationnement par coupons sécurise l’approvisionnement en biens manufacturés des catégories de la population les plus importantes pour le régime. « Les “travailleurs” — qui incluaient les cadres, ingénieurs et autres élites — recevaient 125 coupons, l’équivalent de deux chemises pour homme et trois robes en coton. Les employés de bureau, 100 coupons. Puis venaient les personnes dépendantes et les étudiants, 80 coupons, alors que les zones rurales se voyaient approvisionnées uniquement lorsqu’il s’agissait de “stimuler” les livraisons agricoles (4). »
En l’absence de marché, comment déterminer administrativement les quantités de pantalons, chemises, robes à produire et les modèles à promouvoir ? Les statisticiens du Gosplan observent que les dépenses vestimentaires stagnent à partir d’un certain niveau de revenu : ils reprennent donc ce seuil pour fixer une norme « rationnelle » de consommation par individu et, ainsi, justifier scientifiquement le plan. De leur point de vue, les normes se situent quelque part entre l’ancien monde et le nouveau, entre la demande telle qu’elle s’exprime et les besoins tels qu’on cherche à les façonner. Des « maisons de modèles » (ateliers de création) sont chargées de définir les tendances de la mode et de fournir des prototypes aux usines de confection. Les créateurs soviétiques suivent avec attention la mode parisienne et sont autorisés à en importer les motifs et les techniques jugées utiles. Mais ces innovations esthétiques sont souvent jugées déconnectées des réalités soviétiques, et rarement produites en masse. En bout de chaîne, les vendeurs remplissent leurs rayons en fonction de l’observation des achats passés. Les collections se renouvellent donc lentement. Au début des années 1960, 70 % des vêtements de confection industrielle sont encore fabriqués selon les anciens modèles, la plupart hérités de la période stalinienne. Ce qui poussera, dans les années 1970, à introduire — mais timidement — des outils de suivi de l’évolution de la demande : des « études de marché ».
Entre la créativité hors-sol des « maisons de modèles » et les vêtementsdésuets dans les rayons des magasins, il y a une faille que la société s’empresse de combler. Nombreux sont les Soviétiques qui cousent leurs vêtements à la maison et s’adressent à des ateliers de couture clandestins. La couture à la maison est même encouragée par les autorités, qui diffusent largement manuels et patrons dans l’espoir de desserrer l’étau des pénuries, jusqu’à ce que ce travail domestique prenne de l’importance au point… de concurrencer le secteur d’État. Ce réflexe rappelle par certains aspects les masques dits « alternatifs » que des milliers de Français ont fabriqués chez eux bénévolement, sous le regard bienveillant des autorités incapables d’en fournir à leurs propres fonctionnaires…
Ces difficultés rencontrées dans la production de vêtements renvoient au problème-clé de toute économie administrée : comment, sans liberté des prix, affecter les ressources au bon endroit, au bon moment et sans gaspillage ? Grisée par ses taux de croissance spectaculaires, l’URSS ne prend pas rapidement conscience de cette difficulté. Mais, à mesure que les chaînes de production s’étoffent et se complexifient, les problèmes de coordination s’accumulent. Les autorités y répondent par une mise en ordre bureaucratique. En 1932, on comptait trois commissariats pour l’industrie : avant 1940, trente-deux sont créés.
Débordé par les tâches, le Gosplan se concentre à partir de 1965 sur la planification des matières premières et des équipements stratégiques. Ce qui représente tout de même un document de 11 500 pages dactylographiées réunies en soixante-dix volumes (5)… Les 20 000 autres produits sont confiés à la Commission d’État pour la fourniture en matériaux et équipements (Gossnab) et à ses administrations déconcentrées. En outre, chaque échange physique correspond à une opération financière. Cette tâche revient à la banque centrale, qui s’assure que « l’argent suit le plan » et que la monnaie circule en quantité suffisante pour réaliser les prévisions de vente. C’est dire le nombre d’opérations que doit coordonner l’administration soviétique. Le nombre de valeurs et d’indices que les directions d’entreprise font remonter à leurs superviseurs administratifs se situerait entre 2,7 et 3,6 milliards (6).
Pléthorique, l’information économique dont dispose le planificateur est également de piètre qualité. Les directeurs ont tendance à gonfler leurs besoins et à taire les stocks qu’ils ont constitués pour se prémunir des à-coups, des livraisons de matières premières tardives ou insuffisantes, d’une révision à la hausse du plan de production ou encore d’une panne imprévue. Confronté à des sollicitations incessantes et à des ressources limitées, le planificateur privilégie l’aval des chaînes de production. Par exemple, une usine qui produit du plastique (qu’on retrouve dans une foule de composants d’autres produits) verra ses demandes écoutées avec plus d’attention qu’un atelier de confection : un déficit de plastique déstabiliserait une foule de « balances-matières », contrairement à un manque de pantalons, qui n’incommode que… le consommateur final (7). Or, lorsque ce dernier ne peut plus « voter avec son porte-monnaie », aucun mécanisme démocratique ne permet de contredire ou de compléter les décisions prises par l’administration économique. Et le poids politique des ministères de branche pèse lourd dans les arbitrages. À ce jeu-là, le complexe militaro- industriel se défend bien, et l’industrie légère beaucoup moins.
Résultat : l’économie soviétique souffre d’un défaut de productivité et elle néglige les biens de consommation. À partir du moment où la compétition géopolitique se déplace sur ce terrain, et plus seulement sur celui de la confrontation militaire, Moscou doit employer les grands moyens pour soutenir la comparaison avec les économies occidentales : plus de travail, plus de matières premières, plus de financement. Mais les vigoureuses injections de capitaux produisent de médiocres résultats. Dans les années 1950, l’accroissement annuel de 9,4 % du capital ne produit « que » 5,7 % de production supplémentaire. Au début des années 1960, la croissance commence même à ralentir. Elle s’établit en moyenne à 5,2 % par an sur la décennie.
Les économistes sont appelés au chevet du malade : il faut une réforme, mais laquelle ? Schématiquement, deux écoles s’affrontent. En septembre 1962, l’économiste Evsei Liberman publie dans la Pravda un article intitulé « Le plan, le profit et la prime ». Profit ? Le mot scandalise les économistes orthodoxes. Liberman s’inscrit dans un courant d’inspiration marxiste, critique de la planification, dont les préconisations sont plutôt libérales. Les tovarniks (du mot tovar, qui signifie marchandise) réclament en effet une réforme du système des prix, de manière à refléter au plus juste la quantité de travail contenue dans chaque bien. Et ils préconisent de décentraliser la décision économique.
Ce second volet de leurs travaux inspire une modification majeure des critères de pilotage de l’économie en 1965. Évaluées désormais à partir du chiffre d’affaires, et non des quantités produites, les entreprises sont censées s’intéresser davantage à la qualité de la production. Le paiement d’un « loyer » sur les machines livrées par la centrale doit inciter les directions à un usage plus parcimonieux du capital. En outre, elles sont autorisées à verser des primes aux salariés pour stimuler leur ardeur au travail. On leur accorde également davantage de marges de manœuvre pour effectuer de manière autonome les investissements qu’elles estiment opportuns et établir des contrats avec des fournisseurs.
Alors que ce courant réformiste cherche à imiter le marché, un autre groupe d’économistes-cybernéticiens envisage de parfaire le système planifié. Rassemblés au sein de l’Institut central d’économie mathématique de Moscou (Tsemi), ces chercheurs s’inspirent des travaux pionniers de l’inventeur de la programmation linéaire, le futur « prix Nobel d’économie » Leonid Kantorovich. Ils ont observé avec intérêt la manière dont les grandes entreprises américaines, notamment General Motors, s’appuient sur l’automation pour suivre les coûts de production. Rêvant d’organiser l’économie soviétique à la manière d’une compagnie géante, ils veulent couvrir le pays d’un réseau d’ordinateurs capables de résoudre les immenses problèmes de coordination posés à l’économie planifiée. C’est le projet que porte, depuis Kiev, le cybernéticien Viktor Glouchkov. Un des collaborateurs les plus brillants du Tsemi, Nikolaï Fedorenko, tente de l’aider à vendre aux autorités un « système national automatisé de calcul et de traitement de l’information », embryon de ce qui aurait pu devenir un Internet russe. Il ambitionne d’équiper le pays de vingt mille terminaux connectés à un centre informatique établi à Moscou.
Bien qu’inspiré largement d’observations de l’économie américaine, cette proposition est paradoxalement la plus centralisatrice : elle vise à « armer l’État d’informations et de systèmes de prises de décision corrects, de manière à fonder la planification centrale sur ce qu’il considère comme une vérité scientifique (8) ». Il ne s’agit pas exactement de l’économie numérique qui nous est familière. Chez Amazon, le plan est impulsé par l’aval. Le consommateur se voit forcé d’exprimer ses préférences, que la multinationale stocke de manière à mettre en branle toute la chaîne de production, des chaînes de montage chinoises jusqu’aux entrepôts français. L’utopie cybernéticienne, elle, fait travailler les producteurs dans le sens des objectifs du plan : « Les prix seraient fixés en temps réel de manière à prendre en compte les décisions du Parti, tout en s’assurant que le plan soit équilibré, c’est-à-dire que toutes les ressources sont utilisées efficacement vers la réalisation de l’objectif (9). »
Aucune des deux réformes ne sera menée à son terme. Mise en œuvre partiellement entre 1965 et 1969, la réforme inspirée des tovarniks accentue les tensions au sein de l’économie. Les entreprises se trouvent dans une situation comparable à celle des hôpitaux français en régime de tarification à l’acte. On exige qu’elles soient « rentables » sans qu’elles puissent ni agir sur les prix ni développer pleinement des stratégies de ciblage de leurs clientèles, contrairement à une entreprise privée. Et, tout comme les hôpitaux sont astreints à soigner les patients qui se présentent, les entreprises soviétiques doivent honorer les commandes « urgentes » qu’on leur réclame en haut lieu.
À la faveur des nouvelles facilités bancaires, la dette des entreprises s’envole. Or un combinat soviétique ne fait pas faillite : en cas de défaut de paiement, la Gosbank (banque d’État) se doit d’effacer l’ardoise… et de présenter la facture à l’État, au risque d’une crise des finances publiques. Dans un rapport de 1968, cette dernière préconise alors de « flexibiliser » les prix des biens de consommation ou de faire payer un loyer aux citoyens soviétiques qui jouissent du logement gratuit. Les ultimes conséquences d’une telle réforme reviendraient à mettre en cause le contrat social socialiste, voire à abandonner la planification impérative. Le Gosplan, par la voix de son directeur Nikolaï Baïbakov, attaque alors les « économistes (…) qui souhaitent séparer les prix des lois du socialisme, remplacer les plans quinquennaux par des prévisions de long terme, introduire les pratiques bourgeoises de la faillite (10) ». La réforme est stoppée.
Longtemps discuté, le projet de Glouchkov sera définitivement abandonné en 1970. Confier à la machine informatique le contrôle de la fixation des prix ? Le cybernéticien passe pour un doux naïf… La révolte de Novotcherkassk en 1962, à la suite d’un relèvement du prix des produits laitiers et de la viande — et dont la répression, tenue secrète jusqu’en 1992, a fait au moins vingt-quatre morts —, a montré combien cette question était éminemment politique, trop sérieuse pour être confiée aux mathématiciens. Avec la puissance informatique de l’époque, la masse d’informations que prétendait traiter ce projet aurait nécessité plusieurs millions d’années (11). Les Soviétiques ont néanmoins entrevu les potentialités de l’informatique pour surmonter le problème de coordination des activités économiques qu’ils rencontraient. Ce sont finalement d’autres qu’eux qui ont réussi à utiliser la puissance des algorithmes. Reste à les placer sous contrôle populaire…