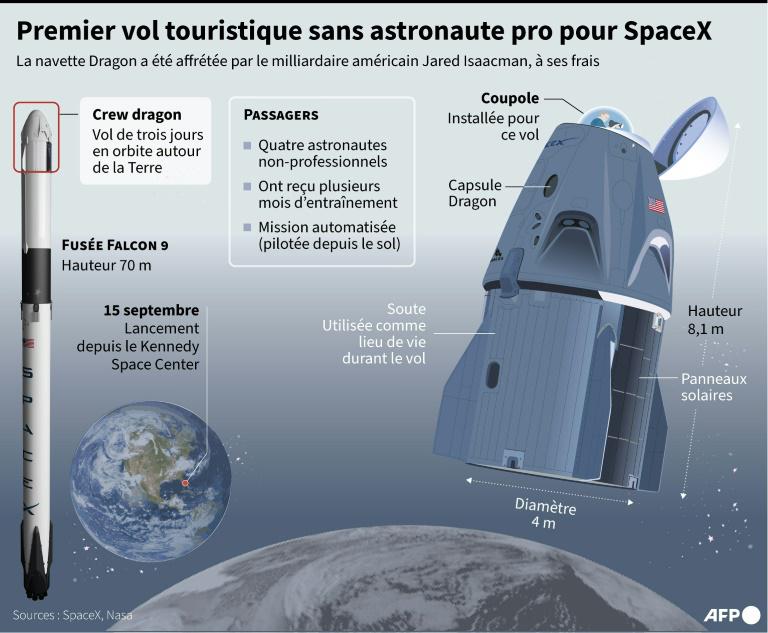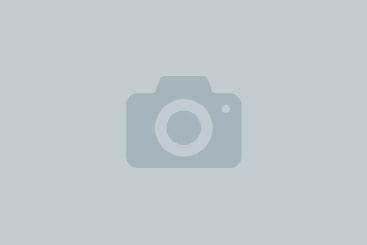Comité pour l'abolition des dettes illégitimes
En cette deuxième décennie du xxie siècle, il y a une circulation des capitaux dont la complexité est sans commune mesure avec celle de «l’ère des empires». Y participent aussi, de façon inégalitaire et combinée, les capitaux privés de certains anciens territoires coloniaux. Jusqu’à bousculer, dans certains cas, la hiérarchie héritée du xxe siècle. Un changement qui pousse même certains à parler, ou à le redouter déjà, d’un «impérialisme à l’envers»[1] censé résulter de la croissance exponentielle du PIBPIBProduit intérieur brutLe PIB traduit la richesse totale produite sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées.Le Produit intérieur brut est un agrégat économique qui mesure la production totale sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées. Cette mesure est notoirement incomplète; elle ne tient pas compte, par exemple, de toutes les activités qui ne font pas l’objet d’un échange marchand. On appelle croissance économique la variation du PIB d’une période à l’autre. de quelques anciennes économies du capitalisme périphérique, voire de l’ancien monde dit communiste, que l’on dit émergentes, avec une focalisation sur la Chine – déjà émergée, devenue même la première économie mondiale (PIB exprimé en parité de pouvoir d’achat), avec des investissements en croissance en Europe et aux États-Unis[2]. quant au dynamisme économique actuel en Afrique, certains n’hésitent pas à parler d’un «temps de l’Afrique» – à venir[3], voire déjà là[4]. Et, allant dans le sens dudit «impérialisme à l’envers», un observateur très bien informé sur les micmacs économico-politico-militaires entre la France et l’Afrique (réduite à sa partie «subsaharienne»), semble en avoir décélé un signe avant-coureur, en évoquant une supposée inversion de la Françafrique en «Africafrance»[5]. Mais la démonstration est assez superficielle, alors qu’est assez manifeste un «redéploiement de l’impérialisme français»[6] en Afrique. L’Afrique continue sa vocation social-historique (capitaliste) d’être un champ de compétition économique des anciennes et nouvelles puissances de la mondialisationMondialisation(voir aussi Globalisation)(extrait de F. Chesnais, 1997a)Jusqu’à une date récente, il paraissait possible d’aborder l’analyse de la mondialisation en considérant celle-ci comme une étape nouvelle du processus d’internationalisation du capital, dont le grand groupe industriel transnational a été à la fois l’expression et l’un des agents les plus actifs.Aujourd’hui, il n’est manifestement plus possible de s’en tenir là. La «mondialisation de l’économie» (Adda, 1996) ou, plus précisément la «mondialisation du capital» (Chesnais, 1994), doit être comprise comme étant plus - ou même tout autre chose - qu’une phase supplémentaire dans le processus d’internationalisation du capital engagé depuis plus d’un siècle. C’est à un mode de fonctionnement spécifique - et à plusieurs égards important, nouveau - du capitalisme mondial que nous avons affaire, dont il faudrait chercher à comprendre les ressorts et l’orientation, de façon à en faire la caractérisation.Les points d’inflexion par rapport aux évolutions des principales économies, internes ou externes à l’OCDE, exigent d’être abordés comme un tout, en partant de l’hypothèse que vraisemblablement, ils font «système». Pour ma part, j’estime qu’ils traduisent le fait qu’il y a eu - en se référant à la théorie de l’impérialisme qui fut élaborée au sein de l’aile gauche de la Deuxième Internationale voici bientôt un siècle-, passage dans le cadre du stade impérialiste à une phase différant fortement de celle qui a prédominé entre la fin de Seconde Guerre mondiale et le début des années 80. Je désigne celui-ci pour l’instant (avec l’espoir qu’on m’aidera à en trouver un meilleur au travers de la discussion et au besoin de la polémique) du nom un peu compliqué de «régime d’accumulation mondial à dominante financière».La différenciation et la hiérarchisation de l’économie-monde contemporaine de dimension planétaire résultent tant des opérations du capital concentré que des rapports de domination et de dépendance politiques entre États, dont le rôle ne s’est nullement réduit, même si la configuration et les mécanismes de cette domination se sont modifiés. La genèse du régime d’accumulation mondialisé à dominante financière relève autant de la politique que de l’économie. Ce n’est que dans la vulgate néo-libérale que l’État est «extérieur» au «marché». Le triomphe actuel du «marché» n’aurait pu se faire sans les interventions politiques répétées des instances politiques des États capitalistes les plus puissants (en premier lieu, les membres du G7). Cette liberté que le capital industriel et plus encore le capital financier se valorisant sous la forme argent, ont retrouvée pour se déployer mondialement comme ils n’avaient pu le faire depuis 1914, tient bien sûr aussi de la force qu’il a recouvrée grâce à la longue période d’accumulation ininterrompue des «trente glorieuses» (l’une sinon la plus longue de toute l’histoire du capitalisme). Mais le capital n’aurait pas pu parvenir à ses fins sans le succès de la «révolution conservatrice» de la fin de la décennie 1970. économique, concernant surtout l’approvisionnement en matières premières, même s’il y a actuellement participation des capitaux privés africains aux circuits de la mondialisation néolibérale. Activisme des puissances qui s’y constate aussi militairement, de façon plus importante qu’auparavant, sous l’étendard de la «guerre contre le terrorisme», «pour parer au chaos qui la menace» – comme dirait l’idéologue de l’impérialisme humanitaire, Robert D. Kaplan[7]. Ainsi, même s’il n’épuise pas les formes de la domination du capital dans les sociétés africaines, l’impérialisme est une réalité indéniable dans l’Afrique actuelle, même au-delà de l’économique et du militaire, comme nous essayons de le démontrer à la fin.
Cession de la souveraineté des États africains
L’Afrique économique actuelle n’est plus celle évoquée par Lénine. Il ne s’agit plus d’un ensemble de territoires coloniaux, mais quasi totalement d’États officiellement souverains avec lesquels les États extra-africains, anciennes puissances coloniales comprises, sont censés avoir des relations de coopération ou de partenariat, dans le respect des engagements internationaux. Cependant, cette souveraineté est assez relative, plombée par la persistante dynamique du néocolonialisme. Les mécanismes de la dépendance subordonnante à l’égard des capitaux extérieurs, de l’exportation des matières premières (brutes), de l’importation des produits manufacturés de l’ancienne métropole coloniale et d’autres puissances économiques n’ont pas disparu. Ils ont été adaptés à la dynamique de l’ordre inégalitaire mondial. C’est ce que manifeste l’actuelle prouesse économique africaine supposée, célébrée presque partout: la croissance moyenne constante de son pib depuis une décennie, autour de 5%, soit au-dessus de la moyenne mondiale et qui s’est, par ailleurs, avérée résiliente au lendemain de la manifestation de la crise des économies du centre capitaliste en 2008, après juste un léger recul en 2009. Le secteur financier a pu y tenir le coup dans l’ensemble, malgré la situation sud-africaine (la plus affectée par la crise).
Loin d’être la preuve d’une dynamique économique endogène, il s’agit plutôt de la manifestation de la domination du capital étranger. La dite croissance est principalement tirée par les secteurs pétrolier et minier – où sont découverts de nouveaux gisements, facteur de plus d’extractivismeExtractivismeModèle de développement basé sur l’exploitation des ressources naturelles, humaines et financières, guidé par la croyance en une nécessaire croissance économique. –, dont les principaux capitaux sont, exception faite du capital minier sud-africain, ceux des transnationales «occidentales» (les sociétés pétrolières et minières nord-américaines et européennes). Ces transnationales, soutenues par «leurs» États, agissent dans un contexte dit de libre concurrence (avec possibilité de partenariat aussi) et non plus en situation de monopole néocolonial – longtemps détenu, par exemple, par l’entreprise pétrolière française Elf (absorbée par Total) au Congo (Brazzaville) et au Gabon. Cette croissance est aussi tirée par l’exportation d’autres matières premières (souvent les mêmes depuis l’ère coloniale) dans les économies non minières et non pétrolières, où s’activent, par exemple, des géants étatsuniens et européens de l’agrobusiness (Cargill, Archer Daniel Midland (ADM), Louis Dreyfus, etc.). Transnationales qui sont aussi attirées par le leadership mondial africain en matière de retour sur investissements ou réalisation des surprofits et la facile «sortie de capitaux illicites» (faite de pillage des ressources, de fraude fiscale, etc.): 528 milliards de dollars, partis d’Afrique subsaharienne, de 2003 à 2012[8], soit une moyenne annuelle de 5,5% du pourcentage de son PIB, la plus élevée du monde[9].
Cette situation est une des conséquences de la réorganisation exogène, à partir des années 1980, des économies africaines à travers les programmes d’ajustement structurel néolibéral incluant la «réforme» des codes des investissements et du travail. Le FMIFMIFonds monétaire internationalLe FMI a été créé en 1944 à Bretton Woods (avec la Banque mondiale, son institution jumelle). Son but était de stabiliser le système financier international en réglementant la circulation des capitaux.À ce jour, 188 pays en sont membres (les mêmes qu’à la Banque mondiale).Cliquez pour plus. et la Banque mondialeBanque mondialeBMLa Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies. En 2011, 187 pays en étaient membres.Créée en 1944 à Bretton Woods dans le cadre du nouveau système monétaire international, la Banque possède un capital apporté par les pays membres et surtout emprunte sur les marchés internationaux de capitaux. La Banque finance des projets sectoriels, publics ou privés, à destination des pays du Tiers Monde et de l’ex-bloc soviétique. Elle se compose des cinq filiales suivantes:La Banque internationale pour la reconstruction et le développement(BIRD, 189 membres en 2017) octroie des prêts concernant de grands secteurs d’activité (agriculture et énergie), essentiellement aux pays à revenus intermédiaires.L’Association internationale pour le développement(AID, ou IDA selon son appellation anglophone, 164 membres en 2003) s’est spécialisée dans l’octroi à très long terme (35 à 40 ans, dont 10 de grâce) de prêts à taux d’intérêt nuls ou très faibles à destination des pays les moins avancés (PMA).La Société financière internationale (SFI) est la filiale de la Banque qui a en charge le financement d’entreprises ou d’institutions privées du Tiers Monde.Enfin, le Centre international de règlements des différends relatifs aux investissements (CIRDI) gère les conflits d’intérêts tandis que l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) cherche à favoriser l’investissement dans les PED. Avec l’accroissement de l’endettement, la Banque mondiale a, en accord avec le FMI, développé ses interventions dans une perspective macro-économique. Ainsi la Banque impose-t-elle de plus en plus la mise en place de politiques d’ajustement destinées à équilibrer la balance des paiements des pays lourdement endettés. La Banque ne se prive pas de «conseiller» les pays soumis à la thérapeutique du FMI sur la meilleure façon de réduire les déficits budgétaires, de mobiliser l’épargne interne, d’inciter les investisseurs étrangers à s’installer sur place, de libéraliser les changes et les prix. Enfin, la Banque participe financièrement à ces programmes en accordant aux pays qui suivent cette politique, des prêts d’ajustement structurel depuis 1982.TYPES DE PRÊTS ACCORDÉS PAR LA BM:1) Les prêts-projets: prêts classiques pour des centrales thermiques, le secteur pétrolier, les industries forestières, les projets agricoles, barrages, routes, distribution et assainissement de l’eau, etc.2) Les prêts d’ajustement sectoriel qui s’adressent à un secteur entier d’une économie nationale: énergie, agriculture, industrie, etc.3) Les prêts à des institutions qui servent à orienter les politiques de certaines institutions vers le commerce extérieur et à ouvrir la voie aux transnationales. Ils financent aussi la privatisation des services publics.4) Les prêts d’ajustement structurel, censés atténuer la crise de la dette, qui favorisent invariablement une politique néo-libérale.5) Les prêts pour lutter contre la pauvreté.Site:les ont imposés aux États du traditionnel capitalisme périphérique, victimes d’un surendettement promu par la Banque mondiale (solution à l’abondance des pétrodollarsPétrodollarsLes pétrodollars sont les dollars issus du pétrole.) à partir des années 1980. Compte tenu du rapport de forces au sein de ces institutions à multilatéralité très hiérarchisée et du poids particulier des intérêts économiques étatsuniens dans la décision de restructuration de l’économie mondiale, la croissance africaine actuelle relève principalement de la soumission à (ou de l’exécution d’un projet de) l’establishment étatsunien, partagé au sein de la Commission trilatérale par les autres bourgeoisies du centre capitaliste qui lui sont subordonnées[10], voire celles qui paraissent adverses.
Mis en dépendance financière asphyxiante, les États africains ont été contraints à une cession partielle de leur souveraineté, déjà relative sous la domination néocoloniale classique. Ils sont ainsi régulièrement soumis aux missi dominici du capital, les institutions financières internationales organisatrices de l’appropriation par les capitaux des puissances européennes et nord-américaines (les «investisseurs stratégiques») d’anciennes entreprises d’État africaines, considérées comme les plus rentables, dans le cadre du Consensus de Washington. Une médecine assez particulière qui s’intéresse plus aux êtres bien portants et délaisse les «canards boiteux». Une nouvelle dépossession «civilisatrice», intégrant ces sociétés dans la phase néolibérale de la civilisation capitaliste, comme la colonisation l’avait fait dans la phase dite aussi de déclin du libéralisme classique.
En rapport avec le remboursement de la detteDetteDette multilatérale: Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.Dette privée: Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.Dette publique: Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics. publique extérieure constituant encore – à travers le paiement des intérêts – une ponction considérable par le capital financier international. Ainsi, en 2004, la CNUCEDConférence des Nations unies sur le commerce et le développementCNUCEDConférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Elle a été créée en 1964, sous la pression des pays en voie de développement pour faire contrepoids au GATT. Depuis les années 1980, elle est progressivement rentrée dans le rang en se conformant de plus en plus à l’orientation dominante dans des institutions comme la Banque mondiale et le FMI. Site web: http://www.unctad.org cachait à peine son émotion en constatant ce qui n’avait cessé d’être dénoncé par les réseaux d’annulation de la dette du tiers monde: «Un coup d’œil rapide à la dette de l’Afrique permet de constater que le continent a reçu quelque 540 milliards de dollars en prêts et a remboursé quelque 550 milliards de dollars en capital et intérêts entre 1970 et 2002. Pourtant, l’encours de la dette est resté de 295 milliards de dollars. Pour sa part, l’Afrique subsaharienne a reçu 294 milliards de dollars de versements, a remboursé 268 milliards de dollars au titre du service de la detteService de la detteRemboursements des intérêts et du capital emprunté., mais conserve une dette active de quelque 210 milliards de dollars […]. Sans tenir compte des intérêts et des intérêts sur les arriérés, le remboursement de cet encours de dette représenterait un transfert inverse des ressources»[11]. Une ponction qui s’effectue dans la sous-région ayant la plus grande proportion de pauvres au monde. La prétendue performance économique actuelle a favorisé un autre cycle d’endettement public (sur les marchés financiersMarchés financiersMarché financierMarché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. À côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales. internationaux), déjà alarmant.
La marque apparente de générosité à l’égard des États dits «très endettés» – allègements ou annulations de dettes – relève plus d’une «faveur» soutenue de façon très intéressée par quelque actionnaire influent de la Banque mondiale ou du FMI. Illustration en a été faite négativement par la pression exercée, il y a quelques années, sur le gouvernement congolais de Joseph Kabila afin qu’il révise à la baisse les termes d’un contrat considéré comme octroyant une situation trop privilégiée à la Chine. En cas d’entêtement du gouvernement de Kinshasa, les institutions financières internationales auraient empêché l’annulation promise d’une part importante de la dette bilatérale de la RD du Congo par le Club de ParisClub de ParisCréé en 1956, il s’agit du groupement de 22 États créanciers chargé de gérer les difficultés de remboursement de la dette bilatérale par les PED. Depuis sa création, la présidence est traditionnellement assurée par un·e Français·e. Les États membres du Club de Paris ont rééchelonné la dette de plus de 90 pays en développement. Après avoir détenu jusqu’à 30% du stock de la dette du Tiers Monde, les membres du Club de Paris en sont aujourd’hui créanciers à hauteur de 10%. La forte représentation des États membres du Club au sein d’institutions financières (FMI, Banque mondiale, etc.) et groupes informels internationaux (G7, G20, etc.) leur garantit néanmoins une influence considérable lors des négociations.Les liens entre le Club de Paris et le FMI sont extrêmement étroits; ils se matérialisent par le statut d’observateur dont jouit le FMI dans les réunions – confidentielles – du Club de Paris. Le FMI joue un rôle clé dans la stratégie de la dette mise en œuvre par le Club de Paris, qui s’en remet à son expertise et son jugement macroéconomiques pour mettre en pratique l’un des principes essentiels du Club de Paris: la conditionnalité. Réciproquement, l’action du Club de Paris préserve le statut de créancier privilégié du FMI et la conduite de ses stratégies d’ajustement dans les pays en voie de développement.Siteofficiel: https://www.clubdeparis.fr/. Le chantage a marché, le contrat a été révisé à la baisse. La portée du partenariat capitaliste de la RP de Chine avec la RD du Congo a ainsi été définie par les traditionnels actionnaires principaux des institutions financières internationales convoitant ses ressources naturelles.
La domination étant plus efficace quand elle est revêtue de quelque vernis «nationaliste», le relais africain de ce pouvoir du capital financier international sur les États est assuré par la Banque africaine de développement (BAD), principale institution financière régionale, superviseuse du Nouveau partenariat économique pour l’Afrique (NEPAD) de l’Union africaine, censé organiser le développement économique de cette région du monde. Présentée comme panafricaine, cette institution financière connaît la participation de 78 États dont 25 non africains, parmi lesquels cinq membres du G7G7Groupe informel réunissant: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon. Leurs chefs d’État se réunissent chaque année généralement fin juin, début juillet. Le G7 s’est réuni la première fois en 1975 à l’initiative du président français, Valéry Giscard d’Estaing. (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Japon) détiennent 25% du capital. Cette participation importante – à laquelle il faudrait ajouter celle des deux autres États du G7, d’autres États européens (Confédération helvétique …) et des puissances dites émergentes – confère un pouvoir de subordination de ses programmes aux intérêts majeurs des puissances traditionnelles. Ainsi, il est presque impossible de distinguer les recommandations de la BAD de celles des institutions de Bretton Woods où la domination des puissances impérialistes traditionnelles, États-Unis en tête, est conservée.
À ce dispositif de dépendance organisée des sociétés africaines, «l’aide publique au développement» donne un air de générosité, alors que le Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde s’interroge: «En 2012, le rapatriement des bénéfices de la région la plus appauvrie de la planète a représenté 5% de son PIB contre 1% pour l’aide publique au développement. Dans ce contexte, il convient de se demander: qui aide qui?»[12].
Union européenne: nouvelles formes de partenariat léonin
En ce qui concerne une grande partie de l’Afrique, cette supposée générosité passe aussi par des accords dits préférentiels, à l’instar de l’Accord entre les États dits d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) d’un côté et la Communauté économique européenne, puis Union européenne, de l’autre. Ces accords – de Yaoundé, de Cotonou, puis de Lomé – ont permis à l’Europe d’acquérir les produits à des prix qu’elle déterminait et de figer ces économies dans l’exportation des produits non transformés, marqués par la spécialisation ou la monocultureMonocultureCulture d’un seul produit. De nombreux pays du Sud ont été amenés à se spécialiser dans la culture d’une denrée destinée à l’exportation (coton, café, cacao, arachide, tabac, etc.) pour se procurer les devises permettant le remboursement de la dette. coloniale.
C’est cette situation de dépendance préférentielle que l’Union européenne a décidé, en 2002, d’adapter à l’ère néolibérale, en l’aggravant, par l’instauration de zones de libre échange dites Accords de partenariat économique (APE). Les États africains concernés (ceux d’Afrique du Nord exclus) étaient censés les signer après cinq ans de «négociations», conformément à la dérogation accordée par l’OMCOMCOrganisation mondiale du commerceCréée le 1er janvier 1995 en remplacement du GATT. Son rôle est d’assurer qu’aucun de ses membres ne se livre à un quelconque protectionnisme, afin d’accélérer la libéralisation mondiale des échanges commerciaux et favoriser les stratégies des multinationales. Elle est dotée d’un tribunal international (l’Organe de règlement des différends) jugeant les éventuelles violations de son texte fondateur de Marrakech.L’OMC fonctionne selon le mode «un pays – une voix» mais les délégués des pays du Sud ne font pas le poids face aux tonnes de documents à étudier, à l’armée de fonctionnaires, avocats, etc. des pays du Nord. Les décisions se prennent entre puissants dans les «green rooms».Site: www.wto.org. Partenariat tellement léonin qu’à la veille du 2e Sommet Afrique-Europe (Lisbonne, décembre 2007), à six semaines de la première date butoir, l’économiste libéral et président du Sénégal, Abdoulaye Wade, le considérait impossible à signer: «C’est une question de survie pour nos peuples et nos économies, déjà très éprouvées […] Si l’Europe n’a plus que la camisole de force des APE à nous proposer, on peut se demander si l’imagination et la créativité ne sont pas en panne à Bruxelles.»[13] La résistance des États et blocs sous-régionaux africains a duré jusqu’en 2014, dernière limite pour la ratification.
Le maintien de l’Afrique pendant cinq décennies dans une forte dépendance à l’égard de l’exportation de produits primaires avait conféré à l’UE assez de pouvoir pour fixer les règles du jeu. Elle a pu imposer la négociation avec des groupements d’intégration sous-régionaux (assez dépendants des apports financiers de l’UE), dont le profil lui convenait, plutôt qu’avec l’Union africaine, selon le principe classique de diviser pour mieux régner; elle a pu les diviser aussi en fonction du degré de dépendance de chaque économie «nationale» de l’exportation vers le marché européen de ses fleurs, ses bananes, son cacao, son coton, etc. Chantage de l’UE et vraies fausses promesses aidant, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté de développement de l’Afrique australe (Southern African Development Community, SADC) – avec un régime spécial pour l’Afrique du Sud –, la Communauté est-africaine (EAST African Community, EAC) ont, en 2014, fini par ratifier un accord «moyenâgeux» selon le Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
Les États africains concernés ont ainsi déclenché un processus de libéralisation, de 75% à 80%, de leurs marchés pour les marchandises de l’Union européenne, étalé, selon les sous-régions, sur 20 à 25 ans. Sans aucun dispositif de «compensation financière»[14]. En échange, ces économies africaines pourront exporter librement 100% de leurs marchandises vers l’Union européenne. Mais, exception faite de l’économie sud-africaine, il s’agira principalement de ce qui, en matière agricole, ne peut être produit en Europe, donc n’est pas en concurrence avec une production européenne. La concurrence que les marchandises africaines devront affronter sur le marché européen est celle des importations similaires d’Amérique latine et d’Asie – parmi lesquelles celles des colonies/néocolonies de l’UE (pays et territoires d’outre-mer, régions ultrapériphériques)[15], faisant, par exemple, de la France un grand producteur d’ananas, de banane et de canne à sucre. La concurrence entre économies dominées de l’ancien tiers monde devant permettre à l’UE d’importer les produits tropicaux aux prix les plus bas possible.
Par contre, exception faite – transitoirement? – de certains produits dits sensibles (viandes, céréales, pâtes alimentaires, poulets congelés, peintures, etc., selon les sous-régions), dont la libre entrée en Afrique serait on ne peut plus catastrophique pour les trésors publics africains et pour une grande partie de la petite production locale, les marchandises de l’UE seront en concurrence avec les africaines. Une vraie concurrence entre inégaux, dans le cadre d’un partenariat prétendu «d’égal à égal».

À l’exception des marchandises provenant d’Afrique du Sud – avec laquelle l’UE a établi des protections, des contingentements tarifaires réciproques, inégaux aussi (105 produits sud-africains sont protégés contre 251 produits européens) – les marchandises africaines déjà produites en Europe ont très peu de chances d’y être compétitives. Elles ne seront même pas compétitives sur les marchés locaux et sous-régionaux africains, compte tenu de la grande faiblesse du commerce intrafricain, car c’est avec le reste du monde qu’elle échange à près de 90%.
Le néolibéralisme promettait pourtant de remédier à cette faiblesse grâce à une dynamique d’intégration économique régionale et continentale. Mais la «négociation» des APE l’a compromise. C’était pour l’Union européenne, une question trop sérieuse pour être traitée avec l’Union africaine: «Dans les relations Afrique-UE, les APE sont les grands absents des réunions et structures officielles UE-UA. L’UE a refusé que le partenariat de la SCAU [Stratégie commune Afrique-UE] sur le commerce, l’intégration régionale et les infrastructures couvre les APE, alors que ceux-ci ont toujours hanté les relations entre les deux continents.»[16] L’UE qui se prévaut de contribuer à l’intégration africaine, a ainsi, tout en la finançant, clairement mis à mal la réalisation ne fût-ce que d’une Union africaine bourgeoisement autonome.
D’où l’opposition aux APE, non seulement des organisations de la production agricole paysanne et de la «société civile» mais aussi de certaines organisations panafricaines du capital, à l’instar de l’Association industrielle africaine (AIA). L’Association des industries du Ghana s’est retrouvée fracturée entre exportateurs de produits tropicaux et producteurs concurrents de marchandises importées de l’UE. Car à travers les APE, l’Union européenne a bel et bien organisé l’étouffement de ces capitaux industriels africains au profit des transnationales européennes exportatrices. Selon l’AIA: «Eu égard à la fragilité des économies africaines, l’inopportunité du libre échange ne fait guère de doute. De nombreuses industries dans cette région sont à peine naissantes. L’ouverture préconisée condamnerait irrémédiablement l’Afrique à demeurer un comptoir d’importations…»[17]. On entend presque Marx disant: «Chaque fois que l’Irlande était sur le point de se développer sur le plan industriel, elle était écrasée et reconvertie en pays purement agricole.»[18]
Ces dernières années ne sont donc pas seulement celles de la croissance du PIB africain, de la multiplication de ses millionnaires et milliardaires, ce sont aussi, de façon apparemment paradoxale, celles de sa «désindustrialisation» suite aux programmes d’ajustement structurel[19].
Tel semble être également le véritable esprit du «Consensus de Bruxelles» que l’UE a proposé à l’Afrique lors du sommet d’avril 2014. L’une des tâches que s’est fixée l’UE étant d’«accompagner le secteur privé dans la conquête des marchés en Afrique». Évalués à «600 milliards en 2013», ces marchés sont «estimés à 1 000 milliards en 2020»[20]. Le dynamisme économique en Afrique est actuellement célébré aussi pour sa prétendue production massive de consommateurs et consommatrices de marchandises des transnationales, le supposé boom des classes moyennes africaines[21]. Construite pour la consolidation de la domination du capital sur les peuples européens et l’acquisition d’une plus grande marge d’autonomie à l’égard du capital étatsunien dans la compétition internationale, l’UE se confirme comme actrice du renforcement de l’emprise de ses capitaux sur les sociétés africaines.
Redéploiement des deux anciennes puissances coloniales
Dans cette nouvelle ruée sur l’Afrique, certains États poursuivent individuellement leur tradition impérialiste, déterminés à «mieux tirer parti de l’héritage colonial»[22]. Par exemple, en décembre 2013 la France a publié un rapport[23] exprimant, plus ouvertement qu’auparavant, la nécessité d’un redéploiement impérialiste. Ce Rapport Védrine affirme la volonté de reconquérir une influence (de l’économique au culturel) qui s’est vue atténuée par le libre-échangisme, l’expansion étatsunienne et la percée de nouvelles puissances – la Chine en particulier. Ainsi la France est déterminée à se situer au-delà de ce qui a été accompli par l’Agence française de développement (AFD), organe coordonnateur du néocolonialisme français en Afrique. Ce qui n’a pas manqué de faire frétiller le Conseil des investisseurs français en Afrique (CIAN) et la section Afrique du Mouvement des entreprises de France (Medef international). Dans cette perspective, le sommet de la Francophonie organisé à Dakar en décembre 2014 a été suivi du 1er Forum économique de la Francophonie. Une continuité peut être établie avec le Forum franco-africain pour une croissance partagée, organisé à Paris en février 2015 et assumant clairement la filiation avec le Rapport Védrine. Le Medef en était le coorganisateur.
De son côté, le Royaume-Uni, beaucoup moins pointé du doigt en Afrique que la France, ne manifeste pas un désintérêt. Si les projecteurs sont plutôt braqués sur l’activisme économique chinois en Afrique depuis une décennie, il s’avère que de 2003 à 2012, ce sont les capitaux du Royaume-Uni qui ont couru en tête en matière de fusions et acquisitions (30,503 milliards de dollars, 437 opérations), suivis de très près par la France (30,472 milliards, 141 opérations), la Chine n’occupant que le troisième rang (20,781 milliards, 49 opérations)[24]. Christian Aid relevait en 2007 qu’en matière de flux financiers entre la Grande-Bretagne et l’Afrique subsaharienne, la première avait envoyé, de juillet 2005 à juillet 2006, 17 milliards de livres sterling vers l’Afrique subsaharienne et avait, en retour, reçu 27 milliards de livres sterling, dont 17 milliards de fuites de capitaux[25]. Qui aide qui?
Le Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni dépense actuellement davantage d’énergie et de papier pour propager l’évangile d’un bonheur ne pouvant être apporté que par le capital privé aux pauvres des sociétés capitalistes sous-développées en général, africaines en l’occurrence. Intérêt pour les pauvres d’Afrique, plutôt que pour les sectateurs du profit, qui est censé avoir motivé la mise en place par Tony Blair de la Commission for Africa, qui a produit en 2005 le rapport Our Common Interest[26]. Intérêt commun aux pouvoirs publics et au capital privé britanniques, voire aux nouveaux capitalistes africains. Tony Blair ne couvrait-il pas les pratiques corruptrices du marchand d’armes de guerre BAE System, dont l’une des victimes a été la Tanzanie[27]?
Un plus grand soutien gouvernemental au capital privé britannique a été par la suite particulièrement justifié en 2011 par le DFID dans The engine of development: the private sector and prosperity for poor people[28]. Au bonheur du Business ActionActionActionsValeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales. for Africa (BAA), le DFID s’active dans le soutien des transnationales britanniques opérant en Afrique, à l’instar d’Unilever (où sont recyclés des ex-ministres britanniques), Diageo (traînée en justice récemment pour versements de pots-de-vin en Asie), Rio Tinto (déjà accusée de complicité de crimes de guerre et génocide en Papouasie-Nouvelle-Guinée et pointé du doigt par des associations paysannes et environnementales à Madagascar, au Mozambique, en Namibie…), Shell (accusée de complicité dans la répression des Ogonis et de falsification des informations sur la pollution pétrolière au Nigeria). C’est sans surprise que le comportement de ces transnationales britanniques (dont la Lonmin responsable du crime de Marikana) demeure marqué par un certain esprit néocolonial: «Aucune des compagnies minières britanniques travaillant au Sierra Leone ne s’est conformée à la loi sur les mines de 2009, établie avec un soutien international pour garantir que les sociétés minières étrangères opèrent de manière responsable (…) Les arguments de ces sociétes concernant l’évasion fiscale sont donc à la fois désuets et non valides.»[29] Ce qu’un porte-parole de la commission ghanéenne de l’énergie a aussi exprimé assez clairement: «Je crois qu’ils pensent que c’est l’Afrique, donc ils peuvent se le permettre.»[30]
Dans la dynamique du «nouveau siècle américain»
Ayant défini le XXIe siècle comme «le nouveau siècle américain», l’impérialisme étatsunien y a évidemment inclus la conquête économique de l’Afrique. Le président Bush père l’avait annoncée[31] et elle a gagné en visibilité avec l’adoption sous Bill Clinton, en 2000, de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA – loi sur la croissance et les opportunités africaines). Une loi dont l’existence ne peut être comprise en ignorant la création, en 1992-1993, du Corporate Council on Africa (CCA) par les principales transnationales étatsuniennes – actuellement 180 entreprises, représentant au moins 85% des investissements privés étatsuniens en Afrique, accompagnées de quelques entreprises africaines: Dangote Group, Ethiopian Airlines, Heirs Holdings, Telkom SA – avec la bénédiction de l’United States Agency for International Development (USAID). AGOA est une version de marché préférentiel, censée accroître les investissements étatsuniens en Afrique et permettre le libre accès sur le marché étatsunien des marchandises produites en Afrique… à l’exclusion des produits agricoles! Ce qui en fait une ouverture restreinte du fait de l’importance de la production agricole dans l’activité économique africaine. Même si Obama a affirmé que «nous n’avons pas besoin des ressources énergétiques de l’Afrique»[32], en matière d’importation l’AGOA demeure principalement portée sur les hydrocarbures (autour de 90%), suivis de produits textiles et de vêtements. Cette loi a prévu des sanctions unilatérales contre tout «partenaire» africain contrevenant aux prétendues «valeurs américaines». Même des idéologues patentés du libre-échangisme n’ont pas hésité à la traiter de «cheval de Troie étatsunien en Afrique»[33].
Fidèle continuatrice de l’administration Clinton en la matière, l’administration Bush fils avait renforcé ce dispositif avec la création du Millenium Challenge Account, un autre instrument «d’aide» aux pays du tiers monde. L’accès à cette «générosité» est conditionné par l’adoption des orientations de l’administration étatsunienne[34]. La liaison de cet instrument public avec le capital privé étatsunien est aussi principalement assurée par l’USAID. L’ère Obama continue cette tradition.
En matière de fusions et acquisitions, selon le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, les États-Unis n’ont occupé que le 5e rang (avec 12,08 milliards $ et 209 opérations en matière de fusions et acquisitions, Afrique du Nord comprise) pendant la décennie 2003-2012, venant même après une puissance économique émergente, l’Inde (4e), avec 15,11 milliards $ et 133 opérations. Le leadership en matière de partenariat commercial avec l’Afrique, auparavant détenu par les États-Unis, lui a été arraché en 2009 par la Chine. Il demeure néanmoins qu’en matière de stocks d’investissements directs étrangers (IDEInvestissements directs à l’étrangerIDELes investissements étrangers peuvent s’effectuer sous forme d’investissements directs ou sous forme d’investissements de portefeuille. Même s’il est parfois difficile de faire la distinction pour des raisons comptables, juridiques ou statistiques, on considère qu’un investissement étranger est un investissement direct si l’investisseur étranger possède 10% ou plus des actions ordinaires ou de droits de vote dans une entreprise.), les États-Unis conservent le leadership, avec 61,4 milliards $ en 2012, contre 27,7 milliards $ pour la Chine, le Royaume-Uni et la France ayant chacune plus du double du stock chinois (respectivement 58,9 milliards $ et 57,9).
Avec un tel stock d’IDE, les transnationales étatsuniennes se caractérisent, tout comme leurs pairs français et britanniques, par une certaine influence sur les politiques nationales des États africains, surtout dans les anciennes colonies britanniques, anglophonie aidant. On connaît le cas classique de Firestone au Liberia[35] ayant depuis 1929 surexploité la main-d’œuvre locale, les terres locales (plantations d’hévéas) et s’étant subordonné un État libérien en situation de quasi-protectorat[36]. Rappelons le cas de Chevron dont le matériel de navigation maritime et aérienne était mis, dans les années 1990, à la disposition de l’armée nigériane pour ses expéditions assassines contre les peuples Ijaws et Ogoni revendiquant la justice sociale dans le delta du Niger pétrolier.
Si l’image de Coca-Cola (considéré comme le principal employeur privé en Afrique avec environ 70 000 employés repartis en 160 usines), n’est pas aussi entachée en Afrique qu’en Colombie et en Inde, cette transnationale étatsunienne est un grand soutien de l’autocrate du Swaziland, le roi Mswati III. C’est dans cette monarchie absolue qu’elle a établi la production africaine du concentré de sa boisson éponyme «en raison de l’arrangement fiscal favorable que le régime lui garantit ainsi que de l’abondance du travail pas cher et du sucre brut (…). Cependant, le véritable problème c’est que Coca-Cola est probablement au Swaziland parce que c’est une dictature qui opprime les syndicats et la population, ce qui permet de maintenir les salaires bas.»[37] On parle, à propos, de «cocacolonisation du Swaziland», car Coca-Cola contribuerait au PIB local jusqu’à hauteur de 40%, selon certaines estimations. Ce qui explique que, jusqu’à une date très récente, les activistes swazi·e·s des droits humains et des libertés étaient quasi inexistant·e·s pour l’administration étatsunienne.
Pour affirmer son leadership mondial[38], le gouvernement étatsunien a initié à son tour en août 2014 un sommet avec les États africains, consacré au partenariat économique avec l’Afrique, au-delà de l’AGOA. L’investissement prochain de 33 milliards de dollars a été annoncé aux chefs d’État africains convoqués à Washington. Stephen Hayes, PDG du CCA, qui s’était plaint du dynamisme étatsunien insuffisant en matière de soutien à l’investissement privé étatsunien en Afrique[39], a été comblé. Cela en dit long sur le besoin d’un État à leur service pour des transnationales encore identifiées à la bannière étoilée, comme à l’occasion de cette cérémonie officielle en Guinée équatoriale où «les drapeaux américains […] étaient portés par une délégation de Mobil Guinée équatoriale, une filiale d’ExxonMobil […] Venaient ensuite des délégations munies de pancartes annonçant Halliburton, ChevronTexaco, Marathon Oil.»[40]
Une «révolution verte» par le «philanthrocapitalisme»[41]
Cette culture d’influence sur le destin des États et des sociétés africaines, inhérente à l’expansion des firmes transnationales, est assez manifeste sur la question vitale de l’agriculture, où le leadership mondial des firmes étatsuniennes est indéniable. De concert avec l’USAID, en 2006, les fondations «philanthropiques» ont créé l’Alliance pour une Révolution verte en Afrique (AGRA). Pavée de bonnes intentions – comme l’était la Révolution verte initiée par les fondations Ford et Rockefeller dans les années 1950 en Amérique latine et surtout en Asie, avec les résultats douloureux que l’on sait – cette nouvelle version néolibérale est le cheval de Troie de l’agrobusiness biotech (Monsanto, Pioneer, Dupont, etc.)[42]. Il s’agit d’une opération visant à imposer les sémences génétiquement modifiées. La philanthropie de la Fondation Gates – qui a dépensé «120 millions de dollars pour le développement des récoltes en Afrique, dont des subventions spécifiques pour la mise au point des cultures GM»[43] – n’est qu’apparente car elle est actionnaire de Monsanto. Guidée par la rentabilité[44] cette fondation «philanthrocapitaliste» fait pression sur les Parlements africains pour qu’ils adoptent des lois favorables à la culture des semences génétiquement modifiées[45], la législation en vigueur dans la très grande majorité des États africains y faisant encore obstacle.
Parmi les dernières offensives du lobbyLobbyLobbiesUn lobby est une structure organisée pour représenter et défendre les intérêts d’un groupe donné en exerçant des pressions ou influences sur des personnes ou institutions détentrices de pouvoir. Le lobbying consiste ainsi en des interventions destinées à influencer directement ou indirectement l’élaboration, l’application ou l’interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, toute intervention ou décision des pouvoirs publics. Ainsi, le rôle d’un lobby est d’infléchir une norme, d’en créer une nouvelle ou de supprimer des dispositions existantes. semencier en Afrique, celle menée au Ghana. Soumis à des difficultés financières depuis au moins deux ans, l’État ghanéen était sur le point de céder à la pression pour l’adoption de la Plant Breeders’ Bill. Cette loi favorable à l’emploi des semences génétiquement modifiées aux dépens des pratiques semencières traditionelles a été pour le moment contrariée par la mobilisation, incluant une campagne internationale d’information. La pression financière apparaît assez bien dans un article qui rapporte le chantage grossier de l’ambassade étatsunienne et d’USAID sur le ministre ghanéen des Finances en vue d’un programme d’assistance quinquennal[46]. L’État ghanéen est dans un dilemme: céder au chantage financier des États-Unis en adoptant la loi (la dette publique étant toujours en hausse en 2015) ou écouter des militants de la souveraineté alimentaire qui sont aussi leaders d’opinion. Postérieurement à la visite d’Obama, le Kenya a annoncé la levée de son interdiction sur les OGMOGMOrganisme génétiquement modifiéOrganisme vivant (végétal ou animal) sur lequel on a procédé à une manipulation génétique afin de modifier ses qualités, en général afin de le rendre résistant à un herbicide ou un pesticide. En 2000, les OGM couvraient plus de 40 millions d’hectares, concernant pour les trois-quarts le soja et le maïs. Les principaux pays producteurs étaient les USA, l’Argentine et le Canada. Les plantes génétiquement modifiées sont en général produites intensivement pour l’alimentation du bétail des pays riches. Leur existence pose trois problèmes.Problème sanitaire. Outre la présence de nouveaux gènes dont les effets ne sont pas toujours connus, la résistance à un herbicide implique que le producteur va multiplier son utilisation. Les produits OGM (notamment le soja américain) se retrouvent gorgés d’herbicide dont dont on ignore les effets sur la santé humaine. De plus, pour incorporer le gène nouveau, on l’associe à un gène de résistance à un antibiotique, on bombarde des cellules saines et on cultive le tout dans une solution en présence de cet antibiotique pour ne conserver que les cellules effectivement modifiées.Problème juridique. Les OGM sont développés à l’initiative des seules transnationales de l’agrochimie comme Monsanto, pour toucher les royalties sur les brevets associés. Elles procèdent par coups de boutoir pour enfoncer une législation lacunaire devant ces objets nouveaux. Les agriculteurs deviennent alors dépendants de ces firmes. Les États se défendent comme ils peuvent, bien souvent complices, et ils sont fort démunis quand on découvre une présence malencontreuse d’OGM dans des semences que l’on croyait saines: destruction de colza transgénique dans le nord de la France en mai 2000 (Advanta Seeds), non destruction de maïs transgénique sur 2600 ha en Lot et Garonne en juin 2000 (Golden Harvest), retrait de la distribution de galettes de maïs Taco Bell aux USA en octobre 2000 (Aventis). En outre, lors du vote par le parlement européen de la recommandation du 12/4/2000, l’amendement définissant la responsabilité des producteurs a été rejeté.Problème alimentaire. Les OGM sont inutiles au Nord où il y a surproduction et où il faudrait bien mieux promouvoir une agriculture paysanne et saine, inutiles au Sud qui ne pourra pas se payer ces semences chères et les pesticides qui vont avec, ou alors cela déséquilibrera toute la production traditionnelle. Il est clair selon la FAO que la faim dans le monde ne résulte pas d’une production insuffisante..
Les Parlements nationaux sont appelés à légiférer en faveur des intérêts des transnationales contre la souveraineté et la justice alimentaires. Ce qui se dit «savoir attirer les investisseurs». Le spectre d’une campagne assez efficiente en Europe et aux États-Unis contre la consommation des produits contenant des OGM (qui a par exemple déjà convaincu la chaîne de restauration rapide Chipotle aux États-Unis) accroît l’intérêt de l’agrobusiness pour l’Afrique, où une expansion des grandes chaînes de distribution des marchandises alimentaires est en cours.
En guise de contribution à la réalisation de ce «progrès» de l’agriculture africaine, la BAD s’est mise au premier rang des promoteurs de la «révolution verte» en appelant au recours aux semences génétiquement modifiées «afin d’améliorer la productivité agricole africaine». Elle a rejoint le premier président – désormais président d’honneur – de l’Alliance pour une Révolution verte en Afrique (AGRA), Kofi Annan, qui devait à sa servilité aux intérêts étatsuniens le poste de secrétaire général de l’ONU. Les saigneurs des peuples trouvent toujours des relais africains[47]. C’est sans surprise que la BAD, cette institution financière dite panafricaine, a choisi de ne considérer ni l’avis des organisations de petits producteurs agricoles, ni les études publiées ces dernières années soutenant que l’agriculture paysanne africaine n’a pas besoin de ces semences génétiquement modifiés pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire[48]. Il ne s’agit plus seulement de subtile imposition d’aliments exotiques du point de vue des sociétés africaines, comme le fait traditionnellement une certaine politique d’aide alimentaire, mais de contrôle de la production des denrées de base de l’alimentation locale.
On ne peut faire injure aux technocrates de la BAD en les pensant dans l’ignorance du fait que cette «révolution verte» ne pourra se réaliser sans l’accaparement des terres, voire des cours d’eau. L’un des tout derniers cas de dépossession c’est l’expulsion par les autorités de l’État de Taraba (Nigeria) de la petite paysannerie locale pour permettre à l’étatsunienne Dominion Farms d’y jouir de 30 000 ha pour la culture du riz. Dominion Farms s’était déjà rendue célèbre au Kenya pour un méfait de même nature. Ces paysans seront contraints de se transformer en prolétaires agricoles surexploités (adultes et enfants en âge scolaire) ou d’aller grossir les bidonvilles – une paupérisation qui sert les programmes de lutte contre «l’extrême pauvreté» des ONG et leurs emplois de missionnaires de l’humanitaire subordonnant, créés aux États-Unis et en Afrique, cofinancées ou soutenues par l’USAID. Vu le caractère «sensible» du Taraba, il n’est pas exclu que le groupe criminel Boko Haram y fasse des recrues, s’il survit à l’actuelle offensive sous-régionale. Au-delà du Nigeria, cette «révolution verte» pourra accroître le nombre de morts parmi les migrants dans le Sahara ou en Méditerranée.
Émergence des nouvelles puissances et l’Afrique
La grande nouveauté dans cette nouvelle ruée sur l’Afrique, c’est l’activisme de puissances économiques émergentes, particulièrement de la Chine (plutôt comme «émergée»), qui s’avère un catalyseur du dynamisme actuel des puissances impérialistes traditionnelles. Ces puissances capitalistes émergées et émergentes ont la particularité d’être situées en Asie et en Amérique latine, voire en Afrique (Afrique du Sud). Autrement dit dans l’ancien «tiers monde» ou «Sud». Pour leur essor elles ne dérogent pas à la quasi-règle de recours à l’Afrique.
Sans avoir le même dynamisme que le capital chinois, les capitaux indiens (secteurs pétrolier, minier, industriel, agricole, téléphonie mobile, produits alimentaires manufacturés, services sociaux etc.) se développent aussi en Afrique s’appuyant sur une longue histoire de relations post-coloniales (non-alignement) et sur l’existence d’une importante population africaine d’ascendance indienne en Afrique australe et orientale (de Maurice au Kenya, en passant par l’Afrique du Sud, mais son premier partenaire commercial – 25% – est le Nigeria).
Tout comme les capitaux brésiliens (secteur pétrolier et gazier, BTP, agrobusiness, exportation des équipements, des produits alimentaires etc.) sont favorisés par la part afrodescendante – pourtant assez discriminée[49] de la population brésilienne et la communauté linguistique avec les anciennes colonies portugaises d’Afrique (l’Angola est la principale terre d’accueil africaine des firmes brésiliennes).
Soulignons aussi, moins évoqués que les autres, les investissements (secteurs pétrolier, forestier, agrobusiness) en provenance de Malaisie – leader en 2012 des IDE en Afrique provenant du Sud. La commune identité religieuse musulmane avec une grande partie de l’Afrique n’est pas étrangère au développement des capitaux des monarchies pétrolières du Golfe (secteurs financier, pétrolier, agrobusiness, etc.). Euro-asiatique, ancienne métropole de l’empire ottoman, la Turquie semble aussi décidée à accroître sa présence économique en Afrique, en deçà de la sous-région septentrionale. Ce qui fait pas mal de monde pour le «gâteau» africain.
L’un des effets de cet activisme de puissances économiques émergentes est une grande attention actuellement portée sur l’Afrique par le complexe académico-médiatique du traditionnel capitalisme central, au nom d’un supposé souci de la protéger d’une prédation de ses ressources naturelles et autres duperies pouvant compromettre sa marche (déjà cinquantenaire mais assez «patinante») vers le développement. Dénonciations de la prédation ou de l’escroquerie de la part des nouvelles puissances économiques, qui rappellent l’une des justifications de la colonisation des sociétés est-africaines à la fin du XIXe siècle: il fallait les protéger de la traite négrière alors effectuée par des trafiquants arabes et swahilis (produits d’un très ancien métissage arabo-bantou). En ce XXIe siècle, il faut protéger les économies africaines de ces nouveaux prétendants au rang de puissance capitaliste, principalement de la Chine située et s’assumant en tête de ce «vol d’oies sauvages»[50] tricontinentales.
Il va de soi que cette nouvelle vague capitaliste n’a pas manqué de perturber la logique du Consensus de Washington auquel serait même opposé un Consensus de Beijing. D’après le sinologue Arif Dirlik, «le terme tire son sens et son charme non pas d’une position économique ou politique cohérente, mais parce qu’il suggère un pôle dans l’économie politique mondiale qui peut servir à rassembler ceux qui sont opposés à l’impérialisme de Washington»[51]. Quant à l’économiste en chef de la BAD, il la définit comme «une approche dans laquelle le développement du secteur privé et la croissance économique tiennent une place centrale et dans laquelle les investisseurs ne s’immiscent pas dans la gouvernance intérieure des pays d’Afrique»[52]. La Chine n’instrumentalise pas le «respect des droits humains» ou de la «démocratie». Le développement du capitalisme chinois relèverait de ce qu’un culturalisme officiel a nommé «conformité aux valeurs asiatiques» se caractérisant, entre autres, par la conception que la démocratie (dite occidentale) n’est pas une condition sine qua non de la performance capitaliste.
Ce résultat du supposé pragmatisme asiatique ne manque pas de susciter des craintes parmi les puissances dominant traditionnellement l’Afrique. Car «l’élite» africaine se tourne désormais souvent vers la Chine. Crainte assez clairement exprimée par la France, qui se plaint de la baisse de ses parts de marché en Afrique, passés de 10% à environ 5% en une décennie[53] ainsi que par le président Obama et l’ancienne secrétaire d’État et éventuelle future présidente étatsunienne, Hillary Clinton, qui ne cessent de mettre en garde l’Afrique contre la nocivité des investissements des puissances émergentes. Les investissements chinois sont ciblés et même considérés comme relevant du néocolonialisme, de l’impérialisme. Accusation relayée en Afrique par, par exemple, l’un des chantres d’une voie capitaliste africaine, alors directeur de la Banque centraleBanque centraleLa banque centrale d’un pays gère la politique monétaire et détient le monopole de l’émission de la monnaie nationale. C’est auprès d’elle que les banques commerciales sont contraintes de s’approvisionner en monnaie, selon un prix d’approvisionnement déterminé par les taux directeurs de la banque centrale. du Nigeria, actuellement émir de l’État de Kano (partie de la République fédérale du Nigeria) et président du conseil d’administration de la filiale nigériane (Black Rhino) du fonds d’investissementFonds d’investissementLes fonds d’investissement (private equity) ont pour objectif d’investir dans des sociétés qu’ils ont sélectionnées selon certains critères. Ils sont le plus souvent spécialisés suivant l’objectif de leur intervention: fonds de capital-risque, fonds de capital développement, fonds de LBO (voir infra) qui correspondent à des stades différents de maturité de l’entreprise. étatsunien Blackstone, Malam Sanusi Lamido Sanusi: «La Chine nous prend des matières premières et nous fournit des biens manufacturés. C’était aussi l’essence du colonialisme […] L’Afrique s’est volontiers ouverte maintenant à une nouvelle forme d’impérialisme.»[54] Accusation dont la réitération suscite désormais des réponses d’officiels chinois. Après le ministre chinois des Affaires étrangères ayant affirmé que les «États-Unis doivent être objectifs et rationnels concernant les investissements chinois en Afrique»[55], le Premier ministre Li Keqiang a tenu à rassurer avant son périple africain de 2014: «Je voudrais affirmer à mes amis africains, avec toute ma sincérité, que la Chine n’entend aucunement agir de façon impérialiste, comme certains pays l’ont fait auparavant. Le colonialisme doit appartenir au passé.»
Impérialisme chinois en Afrique?
Pour son ascension jusqu’aux sommets de l’économie mondiale[56], la Chine a dû s’approvisionner à l’extérieur en ressources énergétiques et minières. Sans originalité, elle s’est tournée aussi vers l’Afrique[57]. Importation de matières premières qui s’accompagne de prêts à taux préférentiels (permettant aussi à certains États de desserrer ou contourner l’étreinte du FMI et de la Banque mondiale, à l’instar de l’Angola), d’exportation de marchandises (plus adaptées au pouvoir d’achat des pauvres d’Afrique) et de savoir-faire (en matière de BTP, par exemple), d’infrastructures publiques (hôpitaux, écoles etc.) en grand déficit pendant des décennies de «coopération» ou d’«aide au développement» de la part des puissances capitalistes traditionnelles, d’investissements dans les secteurs industriel, financier, agricole, etc. En dépit de quelques litiges passagers de certains capitaux chinois avec par exemple les États tchadien ou zambien, la République populaire de Chine est arrivée à faire perdre à Taïwan presque tous ses alliés africains, à l’exception du Burkina Faso, de Sao Tomé-et-Principe et du Swaziland, alors qu’ils étaient encore une dizaine au cours des années 1990. La RP de Chine conditionne sa coopération au respect du principe d’une seule Chine…
Les États africains semblent tirer un profit certain de l’enrobage «Sud-Sud» de la coopération avec la Chine, de sa (relative) bonne santé financière, du dynamisme de ses entreprises publiques et privées, etc. La supposée solidarité à l’égard des États frères du Sud favorise une plus large autonomie néocoloniale des États africains à l’égard des puissances traditionnelles. Celles-ci sont confrontées à une dynamique qu’elles ne maîtrisent pas et à un dilemme: conserver le type traditionnel des relations reviendrait à encourager la préférence africaine pour les nouvelles puissances, mais contribuer en concurrence avec la Chine, voire en collaboration étroite avec elle[58], à un développement capitaliste de l’Afrique, c’est courir le risque de se retrouver avec quelques économies africaines émergentes qui provoqueront davantage de surproduction sur le marché mondial. À l’instar de l’émergence chinoise et son expansion dans le centre traditionnel du capital[59], ayant suscité l’idée de «l’impérialisme à l’envers»[60].
La «solidarité» de la Chine ne se fait pas aux dépens de l’accumulation de sa puissance ni de sa participation en bonne place à la hiérarchie du capitalisme mondial. La concurrence en Afrique entre la Chine[61] et les transnationales enracinées dans les puissances traditionnelles s’accompagne aussi d’une participation chinoise aux structures multilatérales hiérarchisées mises en place par l’impérialisme traditionnel, à l’instar des institutions financières internationales et de leur relais régional qu’est la BAD. La Chine n’en a pas vraiment modifié les règles[62] dont elle veut profiter autant que possible (sur les 150 milliards de dollars chinois investis en Afrique de 2006 à 2014, près de 10% l’ont été dans le secteur financier). Elle participe, sous forme de capitaux aussi bien publics que privés[63], à la consolidation du capitalisme en Afrique. Sa demande de matières premières renforce la dépendance extractiviste des États africains et compromet la conservation dans le sous-sol des ressources pétrolières exigée par la lutte contre le changement climatique.
La participation de la Chine à l’industrialisation de l’Afrique – absente de l’agenda des puissances traditionnelles depuis l’impérialisme colonial –, concerne principalement la création de zones franches («zones économiques spéciales» ou «zones de coopération économique et commerciale»), comme c’est le cas en Égypte, en Éthiopie, à Maurice, au Nigeria, en Zambie. Autrement dit, une délocalisation classique essentiellement motivée par le taux de profit: par exemple, la main-d’œuvre éthiopienne est meilleur marché ou plus productrice de plus-valuePlus-valueLa plus-value est la différence entre la valeur nouvellement produite par la force de travail et la valeur propre de cette force de travail, c’est-à-dire la différence entre la valeur nouvellement produite par le travailleur ou la travailleuse et les coûts de reproduction de la force de travail.La plus-value, c’est-à-dire la somme totale des revenus de la classe possédante (profits + intérêts + rente foncière) est donc une déduction (un résidu) du produit social, une fois assurée la reproduction de la force de travail, une fois couverts ses frais d’entretien. Elle n’est donc rien d’autre que la forme monétaire du surproduit social, qui constitue la part des classes possédantes dans la répartition du produit social de toute société de classe: les revenus des maîtres d’esclaves dans une société esclavagiste; la rente foncière féodale dans une société féodale; le tribut dans le mode de production tributaire, etc.Le salarié et la salariée, le prolétaire et la prolétaire, ne vendent pas «du travail», mais leur force de travail, leur capacité de production. C’est cette force de travail que la société bourgeoise transforme en marchandise. Elle a donc sa valeur propre, donnée objective comme la valeur de toute autre marchandise: ses propres coûts de production, ses propres frais de reproduction. Comme toute marchandise, elle a une utilité (valeur d’usage) pour son acheteur, utilité qui est la pré-condition de sa vente, mais qui ne détermine point le prix (la valeur) de la marchandise vendue.Or l’utilité, la valeur d’usage, de la force de travail pour son acheteur, le capitaliste, c’est justement celle de produire de la valeur, puisque, par définition, tout travail en société marchande ajoute de la valeur à la valeur des machines et des matières premières auxquelles il s’applique. Tout salarié produit donc de la «valeur ajoutée». Mais comme le capitaliste paye un salaire à l’ouvrier et à l’ouvrière - le salaire qui représente le coût de reproduction de la force de travail-, il n’achètera cette force de travail que si «la valeur ajoutée» par l’ouvrier ou l’ouvrière dépasse la valeur de la force de travail elle-même. Cette fraction de la valeur nouvellement produite par le salarié, Marx l’appelle plus-value.La découverte de la plus-value comme catégorie fondamentale de la société bourgeoise et de son mode de production, ainsi que l’explication de sa nature (résultat du surtravail, du travail non compensé, non rémunéré, fourni par le salarié) et de ses origines (obligation économique pour le ou la prolétaire de vendre sa force de travail comme marchandise au capitaliste) représente l’apport principal de Marx à la science économique et aux sciences sociales en général. Mais elle constitue elle-même l’application de la théorie perfectionnée de la valeur-travail d’Adam Smith et de David Ricardo au cas spécifique d’une marchandise particulière, la force de travail (Mandel, 1986, p. 14). que la chinoise, devenue de plus en plus revendicatrice. L’État chinois a choisi la mise en concurrence des prolétariats chinois et éthiopien, en défaveur du premier. Notons que l’un des «meurtriers du prêt-à-porter»[64], l’entreprise suédoise Hennes & Mauritz a aussi manifesté son intérêt pour le très bas prix de la force de travail dans l’atelier Éthiopie[65]. D’autres zones franches y sont donc en projet. Il serait par ailleurs surprenant que la contribution particulière de la Chine à l’industrialisation de l’Afrique soit moins polluante qu’elle ne l’est en Chine, vu que l’écologie est l’un des derniers soucis des dirigeants africains aussi.
Certaines infrastructures de transport construites par la Chine s’expliquent par ces délocalisations. À l’instar du chemin de fer électrique reliant l’Éthiopie à Djibouti accompagné de la perte récente du contrôle du port de Djibouti par la Dubaï Ports World, au profit de la Chinese Merchant Group International (n°1 du secteur en Chine).
Les capitaux chinois participent aussi en bonne place à la lutte contre la petite paysannerie agricole africaine – accaparement des terres agricoles communautaires converties en «terres vacantes» par les autorités nationales. Moins de petits paysans indépendants, un peu plus de prolétaires et de lumpen-prolétaires pouvant être rejoints par celles et ceux ayant subi la destruction de leurs activités par la concurrence faite à la petite production locale, d’autres secteurs économiques, par les produits bon marché «made in China».
Le surprofit néolibéral Sud-Sud réalisé par les firmes chinoises est rapatrié partiellement de façon opaque pour être réinjecté dans les circuits de reproduction. Certaines pratiques du capital chinois privé, surtout en Afrique australe, ne sont pas différentes des trafics françafricains[66], relevant ainsi d’une «ChinAfrique».
Les États africains partenaires, malgré quelques escarmouches (Tchad, Zambie…), ne sont pas disposés à contrarier cette puissance. Bien au contraire, la puissance financière du yuan pousse même certains États (Afrique du Sud, Ghana, Maurice, Nigeria, etc.) à s’en servir déjà comme monnaie internationale à côté du dollar, de l’euro, etc. Une acquisition de la puissance chinoise en Afrique que certains considèrent comme douce, en se voilant la face…
Certes, il ne s’agit plus de l’ancienne «transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires» ayant contribué à la «genèse du capital industriel» (K. Marx), ou de la conquête militaire, suivie d’administration et d’exploitation de territoires, caractéristique de l’impérialisme colonial de la fin du XIXe siècle. Il s’agit d’une nouvelle forme, adaptée à l’époque néolibérale, avec la mémoire de ce passé commun comme différentiateur dans la concurrence intercapitaliste. De façon générale, l’appartenance à des sociétés ayant été victimes du colonialisme ou du néocolonialisme occidental n’empêche pas les capitaux des puissances émergentes d’imiter les pratiques des transnationales ayant leurs racines en Occident impérialiste. Ce que prouvent les capitaux agraires et miniers brésiliens[67], indiens[68], indonésiens etc., impliqués dans la dépossession foncière des populations rurales et la surexploitation de la force de travail, avec la complicité des États africains en quête d’investissements directs étrangers censés les aider à se mettre sur le chemin de l’émergence.
En fait, le cadre des relations Sud-Sud reste hiérarchique: les investissements des puissances émergentes d’Asie et d’Amérique latine en Afrique sont toujours sans comparaison avec ceux réalisés en sens inverse, malgré la croissance de ces derniers. En Chine, «les investissements directs africains […] se sont ainsi établis à 14,24 milliards de dollars fin 2012, en hausse de 44% par rapport à 2009»[69], alors qu’en Inde il est question de «170 millions de dollars cumulés entre 2000 et 2010»[70]. C’est surtout le fait des capitaux sud-africains avec, fin 2013, 36 entreprises en Chine contre 72 chinoises en Afrique du Sud, 54 en Inde contre 115 indiennes en Afrique du Sud. Néanmoins, sans que l’économie sud-africaine soit comparable à la russe, voire à la brésilienne, il y a 25 entreprises sud-africaines au Brésil et 12 en Russie contre respectivement 4 brésiliennes et 12 russes en Afrique du Sud[71].
Panafricanisme… hiérarchique comme le capitalisme
La culture sub-impérialiste, sous-régionale (du Lesotho à l’Angola en guerre), des capitaux sud-africains du temps de l’apartheid constitutionnel, n’a pas disparu avec la fin de ce régime. Elle s’est adaptée à la nouvelle donne post-apartheid – dont elle est, par ailleurs, l’un des facteurs. Par exemple, la transnationale sud-africaine de téléphonie mobile MTN est accusée, comme Coca-Cola, d’être un soutien du régime swazi, en échange d’une faible ouverture à la concurrence – l’autocrate swazi, Mswati III est un actionnaire (à 10%) de la filiale locale. L’État sud-africain post-apartheid sert mieux que ses prédécesseurs l’expansion du capital «national» en Afrique. Le panafricanisme étant ainsi, pour la classe dominante sud-africaine, une version régionale des rapports hiérarchiques Sud-Sud, en vue d’une meilleure place dans le capitalisme mondial hiérarchisé. La NEPAD était pour Thabo Mbeki (vice-président de Mandela, puis président) l’instrument économique de cette Renaissance africaine sous l’hégémonie économique sud-africaine. D’autant plus que grâce au Black Economic Empowerment (soutenu par des grands capitalistes sud-africains blancs) on a assisté à l’émergence de grands capitalistes noirs pouvant servir d’ambassadeurs du capital sud-africain aussi accusé de «pillage interne systématique de l’Afrique»[72].
Le Capital angolais – avec sa croissance à deux chiffres du PIB (principalement extractiviste) pendant près de deux décennies – s’était aussi essayé à une expansion, au-delà de l’enclave du Cabinda, avec ce qui a été considéré comme l’amorce de vassalisation de la Guinée-Bissau: établissement d’une joint-venture pour l’exploitation de la bauxite entre Bauxite Angola (lié à l’État) et l’État bissao-guinéen, avec une répartition de parts respectivement de 90% et 10%. Un partenariat inégal qu’accompagnait le projet de construction par l’Angola d’une infrastructure portuaire à Buba (Guinée-Bissau). En toile de fond de ce deal, la présence militaire angolaise dans le cadre d’une mission de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et du Conseil de la paix de l’Union africaine. L’Angola, pétrolière et minière (diamant, bauxite, etc.), se considère comme leader du CPLP en Afrique et ne cache pas ses prétentions au leadership en Afrique subsaharienne, aux côtés de l’Afrique du Sud et du Nigeria, voire en concurrence. D’ailleurs ses capitaux publics et privés se trouvent déjà au Portugal, l’ancienne puissance coloniale, en position d’actionnaires de référence dans des entreprises stratégiques (banques, télécoms etc.), avec des acquisitions dans l’immobilier, la presse etc. Une expansion métropolitaine qui suscite déjà des commentaires relatifs à l’«impérialisme à l’envers»: «L’afflux des capitaux angolais a enclenché “la transformation la plus importante des secteurs stratégiques de l’économie portugaise depuis la vague de privatisations des années 1990” estime Jorge Costa, dirigeant du parti antilibéral Bloc de gauche et coauteur d’un ouvrage intitulé “les Maîtres angolais du Portugal”»[73]. Mais si le capital angolais est le premier d’une ancienne colonie africaine à en imposer maintenant à son ancienne métropole, «l’ensemble des positions de l’ancienne colonie dans les actions portugaises se monte à 2,8 milliards d’euros, soit 3,8% de la capitalisation du marché actions de Lisbonne»[74] en 2013. Est-ce suffisant pour parler d’un «impérialisme à l’envers», symbolisé par Isabel Dos Santos, fille du président angolais et leader des milliardaires africaines?
Ces dernières années, Forbes, Venture Africa et autres du même acabit publient la liste des milliardaires africains, reprise en boucle, non sans une certaine fierté, dans une grande partie de journaux panafricanistes en ligne: «La seconde édition du classement des Africains les plus riches qui est effectuée par Venture Africa a mis en évidence que l’Afrique compte en 2014, 55 milliardaires (en dollars), dont la fortune globale a progressé de 12,4% entre 2013 et 2014, partant de 143,2 milliards $, à 161,75 milliards $.»[75] Soit, de 2009 à 2015 une quarantaine de multimillionnaires qui se sont enrichis jusqu’à rejoindre les huit milliardaires africains de 2009 (les gouvernants voleurs, plus qu’auparavant la règle en Afrique néolibérale, ne sont pas comptabilisés).
Cette bourgeoisie africaine des nouveaux et nouvelles multimillionnaires et milliardaires, réalise d’importants investissements aux niveaux national, régional (du Caire à Maurice), voire extra-africain: «Entre 2007 et 2012, au cours de la pire récessionRécessionCroissance négative de l’activité économique dans un pays ou une branche pendant au moins deux trimestres consécutifs. de l’économie globale de l’Europe, les investissements africains [y] ont crû sept fois, atteignant les 77 milliards d’euros»[76]. Le principe de son développement était inscrit dans le logiciel du Consensus de Washington: dans le culte du capital privé officié par les institutions de Bretton Woods, est aussi psalmodiée la participation du capital privé national. Des rapports Sud-Sud, tout comme des rapports Nord-Sud, elle n’attend qu’une position considérée comme méritée dans la course à l’accumulation capitaliste, souhaitant, par exemple, des APE qui ne puissent pas l’étouffer.
Nouveaux riches et plus de pauvres
Cette montée en puissance économique de certaines économies du Sud perturbant la traditionnelle hiérarchie Nord-Sud ne déroge pas à une certaine tradition tiers-mondiste: le discours sur la construction de la solidarité ou des échanges Sud-Sud – contre les rapports inégaux Nord-Sud – s’accompagne souvent d’une occultation des inégalités et injustices sociales internes à chaque pays, des antagonismes entre les classes sociales, souvent gérés de façon on ne peut plus répressive. Car on peut parler de leadership africain en matière d’inégalités sociales: «Concernant la richesse, les inégalités les plus criantes sont présentes en Afrique subsaharienne (37%), puis en Asie du Sud (25%). […] Les inégalités de revenus ont diminué en Amérique latine et aux Caraïbes mais semblent avoir augmenté en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.»[77] Inégalités qui résultent du pillage des ressources nationales, des faveurs reçues par accointance avec les autorités politiques – assez évidente pour une Isabel Dos Santos et les multimillionnaires ou milliardaires du Black Economic Empowerment en Afrique du Sud – qui figure actuellement dans le peloton de tête des sociétés les plus inégalitaires du monde.
Selon des câbles diplomatiques étatsuniens, publiés par Wikileaks, les affaires du leader des milliardaires africains, le Nigérian Aliko Dangote, prospèrent aussi grâce à ces accointances parmi les dirigeants politiques. Selon le consul général d’alors, Brian Browne: «Pour ses partisans, il symbolise le fait que les Nigérians peuvent faire mieux que le troc et le commerce. Pour ses détracteurs, c’est un prédateur qui utilise des connexions dans la politique économique corrompue pour faire pencher la balance en sa faveur et écarter la concurrence potentielle. La vérité se trouve quelque part entre ces deux caricatures. Dangote fait partie du premier cercle des conseillers en affaires du président Obasanjo. Ce n’est pas un hasard si de nombreux produits interdits à l’importation au Nigeria font partie de ceux où Dangote a d’importants intérêts.»[78] Il n’y a rien de bien nouveau par rapport aux barons voleurs étatsuniens de la fin du XIXe et du début XXe siècle. Dangote illustre aussi le cynisme des capitalistes africains, y compris dans leur expansion continentale: «Depuis notre arrivée dans cette société en décembre 2014, nous percevons nos salaires plus de 20 jours après la fin du mois et en permanence sous la crainte de ne pas percevoir nos salaires mensuels. Après cinq mois de travail dans l’usine, nous ne sommes pas encore en disposition de nos contrats malgré plusieurs démarches auprès de l’inspection de travail. De ce fait, nous ne disposons d’aucun de nos droits sociaux réglementés par la législation sénégalaise», se plaignaient récemment des ouvriers de sa cimenterie de Pout au Sénégal[79]. Le respect des droits des travailleurs, même réduits à peau de chagrin, n’est pas un trait du capitalisme néolibéral. Par ailleurs, les problèmes environnementaux, surtout relatifs à l’eau, posés par cette cimenterie ne sont pas autrement considérés par celui qu’un journal en ligne de la jeune intelligentsia africaine (Terangaweb, L’Afrique des idées) considère avec une certaine admiration comme «archétype de ces nouveaux titans du capitalisme africain»[80].
Dangote, comme ses semblables africains et extra-africains, profitent des marchés du travail gravement déréglementés par les programmes d’ajustement structurel, contribuant au leadership de l’Afrique subsaharienne en emplois dits vulnérables ou non décents, avec des salaires de survie[81] et des travailleurs salariés pauvres, et de la quasi-inexistence de protection de l’environnement.
Anciennes et nouvelles présences militaires
La domination impérialiste des sociétés africaines à la fin du XIXe siècle et au début du XXe ne s’est pas d’abord manifestée par un afflux de capitaux, mais par l’exercice de la force, la conquête militaire. Cette dimension militaire distingue aujourd’hui également l’émergence de nouvelles puissances capitalistes des pratiques impérialistes traditionnelles.
Parmi les puissances impérialistes traditionnelles, c’est la France qui est demeurée militairement présente en permanence dans les anciennes colonies, après la décolonisation massive du début des années 1960[82]. Une présence militaire accompagnant la préservation de son hégémonie dans ses anciennes colonies subsahariennes[83], voire pouvant favoriser l’extension de sa sphère d’influence, au-delà de son ex-empire colonial – ingérence dans la guerre du Biafra au Nigeria[84]. Elle avait jugé utile de la restructurer dans le contexte post-guerre froide et de néolibéralisation du capitalisme en réduisant le nombre de bases et de troupes stationnées en Afrique. Un certain accent était mis sur la formation des armées africaines dépendantes. Ce qui pouvait aussi être partagé par l’Union européenne construisant sa force d’intervention (Eufor) qui s’est d’ailleurs retrouvée par la suite sous leadership français en RD du Congo, au Tchad et en Centrafrique (bien avant Sangaris). Par reconnaissance de sa tradition africaine, l’armée française a aussi été associée à certains des exercices que l’armée étatsunienne organisait depuis les années 1990 avec des armées africaines, signe de son intérêt post-guerre froide pour l’Afrique (même si l’expression de cet intérêt avait été atténuée par l’échec spectaculaire de l’intervention en Somalie – Provide Relief, puis Restore Hope, 1992-1994).
La superpuissance militaire, présente à Diego Garcia, une de ses principales bases hors des États-Unis, jouissait déjà de la possibilité d’usage de quelques installations militaires, à l’instar de la base aérienne de Thebephatshwa (Botswana), construite avec une aide étatsunienne au moment où se métamorphosait le grand allié sud-africain (la fin de l’apartheid étant censée conduire au pouvoir «les communistes de l’ANC»). Aujourd’hui, l’armée étatsunienne, dotée en 2007 d’un Commandement de l’US Army pour l’Afrique (Africom), est devenue la principale armée étrangère présente en Afrique: en plus de Diego Garcia, elle possède, depuis 2002, une base à Djibouti, au camp Lemonnier (ancien camp français), pour la Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA, intégrée à Africom), ainsi qu’une discrète (souvent secrète) présence dans une quarantaine d’États africains[85]. Cette ubiquité, en guise de compensation à l’échec de la tentative d’installer en Afrique le quartier général d’Africom – installé par défaut à Stuttgart, avec des extensions en Espagne, en Italie et au Portugal –, dont la justification officielle, la «guerre contre le terrorisme», cache mal des intérêts/convoitises économiques, pétroliers en particulier.
Avec sa grossière arrogance, les États-Unis ont profité de la lutte contre Ebola en Afrique de l’Ouest, pour faire la promotion d’Africom en envoyant trois milliers de soldats au Liberia. Une opération de «conquête des cœurs et des esprits» par l’humanisme militaire dont les États-Unis semblaient attendre que la présidente Ellen Sirleaf Johnson (dont la volonté d’accueillir le QG d’Africom, en 2007, fut contrecarrée par l’Union africaine) en profite pour obtenir une prolongation de la présence militaire étatsunienne – comme l’a fait Michel Martelly après le tremblement de terre en Haïti.
Le pivot militaire vers l’Asie n’affecte nullement l’Africom dont la création aussi a pesé sur l’impossibilité de faire aboutir le vieux projet de création d’une armée panafricaine, relancée en 1994 et intégrée, comme Force africaine en attente/African Standby Force, au programme de l’Union africaine. Car tout en proclamant son opposition à l’installation de nouvelles bases militaires étrangères en Afrique, l’Union africaine comptait sur le soutien financier des États-Unis et de l’Union européenne pour l’organisation de cette armée qui devrait permettre à l’Afrique de résoudre elle-même ses problèmes de sécurité. Les interventions des armées extra-africaines, faisant de l’Afrique un terrain d’expérimentation et de publicité de leurs nouveaux instruments de mort ainsi qu’un marché pour les firmes de mercenariat, perdraient toute raison d’être. L’échec de ce projet militaire panafricain explique en partie le bricolage des armées africaines en Somalie, et les interventions militaires françaises au Mali (l’opération Serval a-t-elle contribué à vendre, enfin, le Rafale?) et en Centrafrique. Des interventions impérialistes se drapant d’humanisme grâce à une grossière instrumentalisation du Conseil de sécurité des Nations unies, alors que la situation au Mali[86] résulte non seulement de la persistance du néocolonialisme dans ce pays, mais aussi de la situation chaotique créée en Libye par l’intervention de l’OtanOTANOrganisation du traité de l’Atlantique NordElle assure aux Européens la protection militaire des États-Unis en cas d’agression, mais elle offre surtout aux États-Unis la suprématie sur le bloc occidental. Les pays d’Europe occidentale ont accepté d’intégrer leurs forces armées à un système de défense placé sous commandement américain, reconnaissant de ce fait la prépondérance des États-Unis. Fondée en 1949 à Washington et passée au second plan depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN comprenait 19 membres en 2002: la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, auxquels se sont ajoutés la Grèce et la Turquie en 1952, la République fédérale d’Allemagne en 1955 (remplacée par l’Allemagne unifiée en 1990), l’Espagne en 1982, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque en 1999., ayant contrecarré la médiation de l’Union africaine.
Profitant de certaines appréciations positives de son interventionnisme militaire (assaut final du palais de Laurent Gbabgo pour y installer Alassane Ouattara, Serval, Sangaris), la France en profite pour procéder à une nouvelle restructuration de sa présence militaire. Elle va dorénavant être plus présente, en mixant la coopération et la concurrence avec les États-Unis, dont le déploiement s’accompagne d’une reconnaissance de l’expertise française dans la région. La coexistence d’une base française et d’une base étatsunienne à Djibouti la symbolise.
Site stratégique, Djibouti est devenu emblématique du nouvel intérêt militaire des puissances économiques pour l’Afrique. La protection du golfe d’Aden, fréquenté par les tankers, est en train de transformer Djibouti en hub militaire, au mépris du principe de l’Union africaine sur le non-stationnement permanent des armées étrangères. Aux armées française et étatsunienne, se sont ajoutées les bases japonaise (en 2011) et italienne (accord de 2012), alors que la Chine vient d’obtenir l’installation d’une base militaire, que la Russie et la Canada[87] négocient pour pouvoir s’y installer également et que les militaires espagnols et allemands sont présents, sans disposer de bases permanentes.
L’armée japonaise[88] dispose de 600 soldats dans sa base à Djibouti et y dépense 30 millions de dollars de loyer. C’est une armée actuellement en pleine mutation, se caractérisant principalement par le retour à une armée «normale» de puissance économique[89]. L’actuel Premier ministre Shinzo Abe ne cache pas sa nostalgie du militarisme japonais tout en conservant la subordination japonaise au leadership étatsunien.
La Chine a entrepris de rompre avec une certaine retenue. L’armée chinoise veut aussi être présente en Afrique de façon indépendante des missions onusiennes (RD Congo, Soudan du Sud) ou différemment du soutien peu médiatisé apporté à la coalition de «lutte contre le terrorisme» au Mali. C’est ainsi qu’elle a obtenu l’installation prochaine d’une base militaire à Djibouti. Une présence qui se justifierait, au-delà des enjeux africains, comme une réponse aux tensions en Mer de Chine méridionale: «Beijing forge sa capacité future à entraver chirurgicalement et stratégiquement l’endiguement militaire étatsunien»[90]. Il est aussi question d’une éventuelle base militaire dans le port de Walvis Bay en Namibie. Ce qui confère au volet militaire de la coopération sino-africaine une importance croissante. La vente chinoise d’armes n’étant pas soumise à la duplicité des autres champions, habiles à décréter des embargos. Même le Gabon, ce fief de l’armée française, effectue des manœuvres militaires avec la Chine. En matière militaire, encore plus qu’en matière économique, le leadership chinois dans ces rapports Sud-Sud est évident. Mais, pour le moment, à la différence de ce qui prévaut en mer de Chine méridionale entre la Chine et les États-Unis, il n’y a pas (encore?) en Afrique de tensions militaires entre les puissances traditionnelles et celles dites émergentes.
Une exception: l’armée sud-africaine s’étant retrouvée en situation de concurrence avec l’armée française dans la Centrafrique de François Bozizé[91]. Au titre d’un partenariat militaire, l’armée sud-africaine y avait été envoyée en soutien à ce régime chancelant ayant perdu le soutien de la France. Il s’agissait aussi d’y sécuriser les intérêts du capital sud-africain. Des soldats sud-africains ont été tués par la rébellion centrafricaine, qui a finalement renversé le régime de Bozizé. L’armée française y a retrouvé sa place dominante avec l’opération Sangaris.
Idéologie (encore plus) dominante
Le dynamisme actuel du capital extra-africain en Afrique ne s’accompagne pas seulement d’un activisme militaire de la part des puissances traditionnelles et émergentes. Il y a la dimension idéologique ou culturelle, facteur du consentement, un pilier de l’hégémonie gramscienne. Là aussi le néolibéralisme a modifié les règles de la domination.
Au temps colonial et durant les deux premières décennies postcoloniales, l’Afrique n’avait pas échappé au bouillonnement intellectuel mondial, caractérisé par une dynamique réflexive critique de l’impérialisme et du capitalisme, parfois articulé à une pratique politique. Si les intellectuels africains du camp néocolonial, y compris les «apolitiques», étaient les plus nombreux, on pouvait parler de pluralité s’exprimant localement (quand les régimes le toléraient) ou en exil.
Ce n’est plus tout à fait le cas depuis la fin des années 1980, avec le backlash amorcé au cours de la décennie précédente, ayant favorisé l’intégration de nombreux anti-impérialistes et anticapitalistes dans des structures du pouvoir au niveau national ou dans les organisations internationales. Le salariat dans celles-ci a finalement abouti à leur transformation en carriéristes. L’échec devenu incontestable du bloc dit communiste, au moment où l’ajustement structurel néolibéral s’imposait en Afrique, a aggravé la situation en rendant plus déficitaire la pluralité des idéaux socio-politiques. Le vent de la «démocratisation» a consolidé l’hégémonie des valeurs capitalistes en Afrique. La remise en question de l’ajustement structurel a été étouffée dans les conférences nationales souveraines et autres procédures de réformes politiques. Il s’agissait de graver dans le marbre l’économie de marché. C’est la Banque mondiale qui organisait la lutte contre la pauvreté extrême – produite par les programmes qu’elle imposait avec le FMI – avec l’aide des agences onusiennes, des ONG de développement, des organismes caritatifs, etc.[92]. La mondialisation néolibérale était supposée rendre heureux les misérables qu’elle produisait: de la pauvreté extrême, ils allaient passer à la pauvreté, non par le développement de quelque «État social» ou «État Providence», dont certaines sociétés africaines avaient connu une version sous-développée pendant environ deux décennies, mais par le développement du secteur privé.
Ce sont aussi les fondations philanthropiques (le «philanthrocapitalisme») qui sont appelées à sauver le monde en résolvant les grands problèmes sociaux de l’humanité. Cette supposée générosité, fiscalement bénéfique aux donateurs, participe à la propagation de la pensée unique du Consensus de Washington. Les plus riches du monde, Bill et Melinda Gates (Fondation Gates), sont montrés volant au secours des Africains malades du sida, en se subordonnant l’OMS[93]. Les enfants africains vont à l’école grâce à quelques stars du show-business, avec lesquelles les Africains de l’Africa Progress Panel posent en photo, l’air honoré. Telles sont les réalités de la subordination du public au privé, alors que l’argent public est volé par des gouvernants. En soutenant de concert avec les chancelleries du capitalisme central certaines organisations ou mouvements de défense des droits humains et des libertés, ce philanthrocapitalisme impose sans effort des limites aux perspectives d’émancipation de même qu’à la critique des situations locales et des États d’enracinement des fondations sponsors.
Les Africains salariés de l’Open Society de George Soros ne doivent pas dépasser sa critique superficielle du capitalisme[94] et il va de soi que sa participation à l’accaparement des terres et à l’exploitation des travailleurs n’est pas considérée comme une violence faite aux humains. Un dirigeant du mouvement sénégalais «Y en a marre» (qui a joué un rôle majeur dans la mobilisation contre la tentative de troisième mandat d’Abdoulaye Wade et pour «l’alternance démocratique») a ainsi justifié la collaboration avec G. Soros[95] après avoir soutenu la campagne présidentielle du milliardaire libéral Macky Sall, et fait l’éloge d’Obama («un président sympa et attentif, qui s’est montré très pragmatique»[96]): «“Y en a marre” ne dépend ni du marxisme, ni du capitalisme, ni du communisme, nous ne dépendons d’aucun bord et nous voulons faire une philosophie d’action citoyenne fondée sur des valeurs africaines et sur nos réalités socioculturelles. Les gens qui ne conçoivent pas ça sont donc dérangés, mais ils sont libres de penser ce qu’ils veulent.»[97] Ce genre de salmigondis idéologique est dans l’air du temps. La situation n’est pas différente du côté des dirigeants du «Balai citoyen» (un des principaux collectifs acteurs du dégagement de Blaise Compaoré) et d’autres mouvements du même type ailleurs en Afrique. Certains critiques des États africains les considèrent comme «les nouveaux “tirailleurs” de l’impérialisme en Afrique» ou des «nègres de service de l’empire»[98].
La conception superficielle de la démocratie qui prévaut dans ces mouvements africains reflète aussi un contrôle des diplômés africains par l’impérialisme, sous la forme des bourses académiques et des postes d’enseignement. Les États-Unis attirent davantage de diplômés africains à travers, par exemple, le Partnership for African Universities, lancé à Dakar en 2000 et porté principalement par les Fondations Carnegie, Ford, MacArthur et Rockefeller. Une décennie plus tard, des intellectuels africains demandent davantage de «partenariat» des universités africaines avec les fondations étatsuniennes[99], actrices majeures de la nouvelle organisation de l’enseignement supérieur hostile au principe d’acquisition du sens critique, qui s’était fait une petite place dans certaines universités. Les laboratoires de recherche agronomiques sont de plus en plus subordonnés aux financements de l’agrobusiness. La réflexion sur la société est de plus en plus appréciée selon les paradigmes promus par quelques think tanks et s’imposant aux revues rendues les plus influentes. Un économiste africain qui ne se revendique pas révolutionnaire déplorait il y a quelques années: «On est dans des situations caractérisées par l’absence de discussion des paradigmes macroéconomiques et par l’improvisation face aux défis sociaux. Les universitaires africains, du moins en Afrique francophone, celle que je connais, ne discutent absolument pas des paradigmes. Il n’ y a pas, à l’heure actuelle, de débat sur la science économique […] Ceux qui sont à la tête des institutions ne mènent pas de réflexion théorique poussée et ceux qui sont dans les universités n’ont pas de prise avec le réel. […] La dissidence a un coût, et c’est pourquoi l’orthodoxie est si peu remise en cause. On est dans des logiques “de ventre”où il y a captation.»[100] En la matière, les puissances émergentes se contentent d’une rivalité en matière d’offre de bourses, la Chine en tête, mais sans être prête à égaler les anciennes puissances coloniales.
Parmi les moyens d’influence de l’impérialisme ou néocolonialisme en son temps, Kwame Nkrumah incluait Hollywood, symbole des «industries culturelles» propagatrices de l’ «american way of life». Il écrivait: «Même les scénarios d’Hollywood sont des armes. Il suffit d’écouter les applaudissements des spectateurs africains quand les héros hollywoodiens massacrent les Indiens ou les Asiatiques pour se rendre compte de la puissance d’un tel moyen.» Cette puissance des industries culturelles impérialistes s’est accrue de façon exponentielle, y compris sous la forme d’adaptations locales: la chaîne de télévision chinoise CCTV installée à Nairobi[101], les télénovelas, les films de Bollywood et de Nollywood…
Cependant, pour Nkrumah, l’une «des méthodes les plus insidieuses employées par le néocolonialisme est peut-être l’évangélisme. À la suite du mouvement de libération, on a assisté à un véritable raz-de-marée de sectes religieuses, en grande majorité américaines.»[102] Ce processus s’est intensifié à partir des années 1980-1990, comme un «arôme spirituel» des conséquences sociales de la crise de la dette et des «remèdes» des institutions de Bretton Woods. L’expansion des églises de réveil ou du pentecôtisme s’accompagne assez évidemment d’une place centrale accordée à l’argent consacrée par les fortunes colossales des pasteurs, disciples de Dieu et de Mammon en même temps.
Face à cette emprise de l’impérialisme capitaliste, désormais renforcée par les puissances capitalistes émergentes, complices et concurrentes de l’impérialisme traditionnel, ainsi que par la croissance du capitalisme africain, les peuples africains, exploités et opprimés, ne se résignent pas à l’assujettissement, malgré tout. Comme le prouvent les luttes menées ici et là, dans cette région du monde, contre l’exploitation humaine et écocide par les transnationales pétrolières et minières[103], l’accaparement de terres communes et l’imposition de semences asservissantes, les injustices et inégalités reproduites par les cliques alternantes de gouvernants voleurs, acteurs du capitalisme africain, la discrimination censitaire concernant l’accès à l’enseignement supérieur, aux soins de santé, l’instrumentalisation politicienne et mortifère des identités ethniques/raciales et confessionnelles, les oppressions se fondant sur des conceptions néocoloniales et obscurantistes des «traditions africaines», etc. Des luttes que, trop souvent, le dispositif néocolonial, au service du bloc capitaliste (impérialisme traditionnel, puissances émergentes, capital africain) parvient à isoler les unes des autres aussi bien au niveau local que panafricain, voire international extra-africain, à contenir, à orienter selon ses intérêts. Sans la construction et la consolidation des solidarités populaires et des convergences dans les luttes contre les différents tentacules de la pieuvre capitaliste en Afrique, autrement dit une dynamique panafricaine anticapitaliste, il n’y aura pas d’émancipation du peuple africain exploité et opprimé et de participation à la construction d’une humanité du bon vivre.